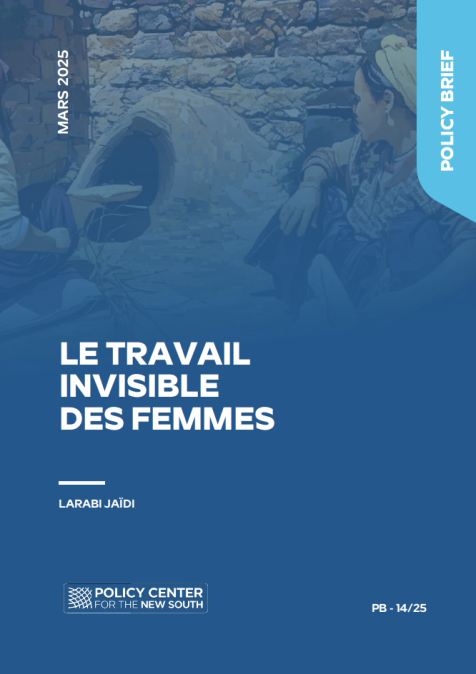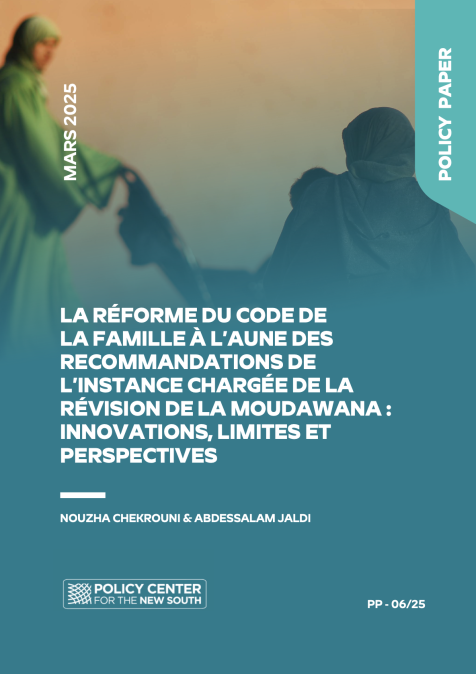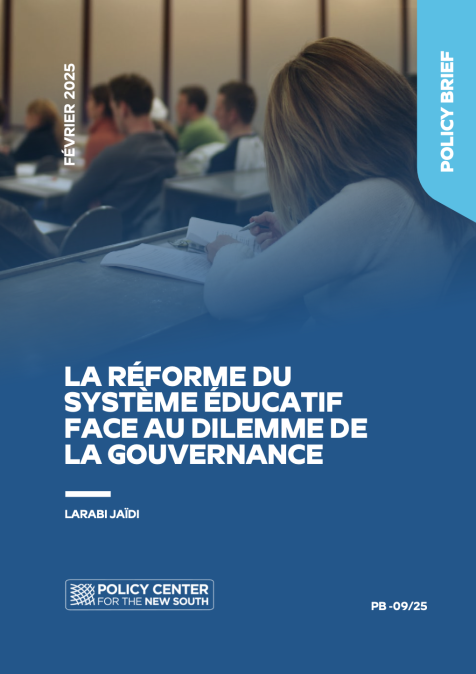Publications /
Policy Brief
La justice sociale est un enjeu central, mais son application reste floue, car l’égalité réelle exige des mesures concrètes pour corriger les inégalités héritées. Les débats philosophiques et économiques opposent ceux qui défendent l’égalité des chances à ceux qui plaident pour une redistribution plus active des richesses. Au Maroc, bien que la justice sociale soit un leitmotiv dans les discours politiques, son impact reste limité par un manque de suivi et d’engagement sur le long terme. Les inégalités territoriales persistent, accentuées par une concentration économique sur le littoral au détriment des régions intérieures. Cette fracture se reflète dans l’ascenseur social, qui peine à fonctionner pour les jeunes générations, freinées par un marché du travail rigide et des opportunités inégales. Face à ces défis, les politiques publiques doivent être repensées pour garantir une protection sociale plus efficace et une redistribution équitable des opportunités, afin de restaurer la confiance dans le système et favoriser une société plus juste.
Introduction
La réflexion sur la justice sociale est d'autant plus complexe que la notion d’égalité à laquelle elle est associée est mal définie. La notion de justice sociale renvoie à des théories modernes de la justice qui, parce qu’elles respectent le pluralisme des valeurs morales des citoyens, s’assurent le respect par chacun de l’organisation des libertés individuelles au niveau collectif. L’objectif des théories de la justice sociale est d’élaborer des principes qui puissent être cohérents et opératoires, c’est-à-dire susceptibles d’être traduits en termes d’actions de politiques publiques.
L'objet même d’une politique publique ou de la politique tout court est la délibération sur les normes de la justice présidant à des choix. La décision publique ou politique, principalement dans un régime démocratique, consiste avant tout à départager le champ de ce qui doit être égal et de ce qui peut rester inégal. Le débat sur les inégalités et la norme de la justice sociale s'inscrit à l'évidence dans le cours de cette délibération. Le principe d’Égalité, appuyé sur celui de Légalité, reste inscrit dans les constitutions de tous les systèmes politiques, dont le notre. Il n’est pas, non plus, de ceux qu’on discute ; il se constate. Il répond à un besoin inconditionnel. Il revient à la Justice de le mettre en mouvement ; elle est chargée en quelque sorte de ramener les inégalités de fait à l’égalité de principe.
Le débat national sur la justice et l’égalité est trop souvent subordonné à de fortes bouffées de demandes d’égalité que le système politique est sporadiquement obligé, à travers ses partis, de prendre en compte sans avoir le temps de les traiter correctement sur une longue durée, ce qui aboutit à des déceptions. À l’évidence, s’il est un problème qui doit être traité en continu et sur le long terme, c’est bien celui-là. Cette réflexion sur les principes de justice est doublement nécessaire. Elle l’est, d’abord, économiquement, car, pour définir correctement les politiques publiques, nous avons besoin d’une pensée claire sur les questions d’égalité et de justice, qui constituent des aspects fondamentaux de ces politiques. Elle l’est, ensuite, politiquement, car elle constitue une exigence de la démocratie : pour bien fonctionner, celle-ci a besoin de principes régulateurs des conflits et de mécanismes de prévoyance sociale efficients.
Un détour théorique nous permettra, dans cet article, de mettre en exergue la complexité des notions de justice et d’égalité, de voir dans quelle mesure ces notions sont comprises et intégrées dans les discours politiques nationaux, indépendamment de leurs référentiels idéologiques. Ce détour réflexif rendra plus lisibles l’observation et l’appréciation des dimensions socio-spatiales de la justice sociale au Maroc, de l’évolution de la mobilité sociale comme forme d’expression de la tendance vers une société plus ouverte et plus juste malgré les dysfonctionnements des politiques publiques.
Un détour théorique pour apprécier la complexité des notions de justice et d’égalité
L'idée d'égalité est confrontée à deux types de diversité : l'hétérogénéité des êtres humains et la multiplicité des variables en termes desquelles l'égalité peut être appréciée, rappelle Amartya Sen. La formule « Tous les hommes naissent égaux » et la puissante rhétorique de l’« égalité des hommes » détourne l’attention des différences des caractéristiques internes des personnes (âge, sexe, aptitudes, compétences, vulnérabilités) et des différences des circonstances externes (héritage et propriété de biens, origine sociale, environnement). Une considération égale pour tous peut impliquer un traitement inégal en faveur des désavantagés. Ignorer les distinctions entre les individus peut se révéler une démarche inégalitaire. L’égalité réelle exige des mesures étendues et complexes lorsqu’il s’agit de contrarier un lourd héritage d’inégalité.
L’estimation et la mesure de l’inégalité dépendent du choix de la variable (revenus, fortunes, bonheur, etc). Des personnes différentes peuvent retenir une « variable focale » différente, comme centre d’intérêt privilégié. Une variable focale peut présenter une pluralité interne, dans un ordre différent. Le rejet de l’égalité sur une variable focale peut être combiné à l’adhésion à l’égalité sur une autre. Un risque de conflit entre deux égalités peut survenir ou se produire : le choix d’une variable peut agir comme une contrainte sur la nature des autres décisions sociales. L’exigence d’égalité sur une variable tend à entrer en collision avec la volonté d’égalité sur une autre. Ce constat soulève une autre question : peut-on appliquer un principe classificatoire aux égalités ? Peut-on repérer les propriétés invariantes et les relations fortuites ou conditionnelles entre deux égalités? La réponse à ces questions est d’autant plus compliquée que les caractéristiques de l’inégalité dans des espaces différents tendent à diverger entre elles, en raison de l’hétérogénéité des individus. Comparer les personnes entre elles introduit nécessairement la question des inégalités et conduit à s’interroger sur le sens de la justice sociale.
Toutes les théories existantes en économie du bien-être et en philosophie politique (l’utilitarisme, le ressourcisme rawlesein, le libertarisme, etc.) témoignent d’une volonté d’égaliser les situations des individus dans tel ou tel espace : égalité des personnes dans la procédure d’agrégation des utilités, égalité des libertés de base chez Rawls, égalité des droits formels pour les libertariens, etc. Les théories économiques ont toujours été confrontées à la difficulté de concevoir une économie qui, à la fois, privilégie l’allocation optimale et la répartition égalitaire des ressources. L’optimum économique au sens de Pareto reflète une allocation optimale des ressources, et la répartition est équitable mais elle pourrait être inégalitaire. Les auteurs de l’école classique ont fondé des théories qui ne se préoccupent que de la question de la richesse.
Rawls énonce deux principes de justice afin de répartir les droits fondamentaux et les avantages tirés de la coopération sociale. Un principe d’égale liberté : « chaque personne a droit à un ensemble parfaitement adéquat de libertés de base égales compatible avec le même ensemble de libertés égales pour les autres. Second principe : les inégalités économiques et sociales satisfont deux conditions : d’abord (principe de justice égalité des chances) elles se rapportent à des postes ou fonctions ouverts à tous dans des conditions d’égalité équitable de chances (b) : ensuite (principe de différence) elles doivent exister pour le plus grand bénéfice des membres les moins avantagés de la société. Rawls donne une priorité au premier principe d’égale liberté, sur le second, et au sein de ce dernier au principe d’égalité des chances sur celui de différence. Le principe de différence, principe de justice économique, est ainsi subordonné aux deux principes de justice politique. Autrement dit, aucune restriction de liberté ou la moindre inégalité de chances ne peuvent être légitimées par le fait qu’elles amélioreraient le sort matériel des plus démunis. Les libertés de base ne sont donc pas seulement formelles mais réelles.
De ces principes découle la conception de « justice comme équité » : l’égalité des libertés et des chances doit être garantie mais certaines inégalités seront considérées comme justes, dès lors qu’elles sont à l’avantage des plus démunis (principe de différence). Une « inégalité juste » est donc équitable. L’égalité garantie ici ne porte pas sur les réalisations des individus mais sur les moyens dont chacun dispose via les biens premiers sociaux, d’atteindre un certain niveau de bien-être.
Ce sont ces « biens premiers » qui intéressent Rawls, car c’est du caractère juste de leur distribution, choisie et non aléatoire, que dépend le caractère juste d’une communauté politique donnée. Ceux-ci regroupent : les libertés fondamentales, l’accès aux différentes fonctions de la société, les pouvoirs et avantages liés à ces fonctions, les revenus et les richesses, et le respect de soi-même. Ces biens premiers sont connus de tous sous le voile de l’ignorance, désirés par tous : c’est le panier de biens premiers qui leur permettra de mener la vie qu’ils estiment bonne. Aussi, les principes de justice adoptés doivent-ils être tels que chacun les acceptera, quelles que soient ses valeurs morales ou religieuses ou philosophiques : la priorité est ainsi accordée au juste sur le bien.
Dans sa critique des conceptions égalitaristes, Sen a proposé une synthèse qui se réapproprie le parti pris des libertariens en faveur du processus de choix et de liberté d’agir et l’attention de la théorie de Rawls à l’égard de la liberté individuelle et des ressources nécessaires aux libertés substantielles. Pour lui, sélectionner un type d’information pour décrire les inégalités (le revenu, la fortune, les conditions de vie, le bien-être subjectif, etc.) ne peut être neutre d’un point de vue éthique et politique. Il reproche également à cette conception de ne prendre en compte que les accomplissements des personnes, par opposition à leurs libertés d’accomplir (les alternatives disponibles). Sen va consolider son approche en discutant la théorie rawlesienne de la justice, et plus particulièrement sa base informationnelle centrée sur les biens premiers. Il substitue une base informationnelle centrée sur les « capabilités » individuelles aux variables ressourcistes. En termes de base informationnelle ; s’arrêter aux moyens que possèdent les personnes est insuffisant, pour la simple raison qu’elles n’ont probablement pas la même capacité à convertir ces ressources en accomplissements ou en réalisations identiques.
La base informationnelle n’est pas limitée aux moyens de la liberté, mais vise à renseigner plus directement sur l’étendue de cette liberté elle-même. Cette liberté réelle qu’on appelle la « capabilité » de l’individu d’accomplir diverses combinaisons possibles de fonctionnements constituant le cours de la vie auquel il aspire. Le cours d’une vie d’une personne est l’ensemble des fonctionnements que l’on ne peut pas réduire à un ensemble de ressources : par exemple savoir lire, écrire, avoir un travail, être politiquement actif, être respecté des autres, être en bonne santé physique et mentale, avoir reçu une bonne éducation, et une bonne formation, être en sécurité, avoir un toit, etc.
L’approche par les capacités a une application immédiate : proposer une nouvelle façon de concevoir le développement économique et la pauvreté. « Le développement peut être appréhendé comme un processus d’expansion des libertés réelles dont jouissent les individus. En se focalisant sur les libertés humaines, on évite une définition trop étroite du développement, qu’on réduise ce dernier à la croissance du produit national brut à l’augmentation des revenus, à l’industrialisation au progrès technologique ou encore à la modernisation sociale ».[1] La théorie des capacités reste cependant incomplète. Et cette incomplétude se manifeste au double niveau de la sélection des différentes dimensions à intégrer dans l’évaluation : quels fonctionnements réalisés et réalisables considérer et évaluer ? Et quelle hiérarchisation de ces dimensions ?
La justice sociale dans le discours politique marocain : quelle source d’inspiration ?
La justice sociale, à considérer l’éventail de ses paradigmes, fournit aujourd’hui aux partis politiques marocains, dans le large spectre de leur référentiel idéologique, une valeur de référence assurée d’un consensus dans la « psyché collective ». À ce titre, elle a toujours une valeur qui figure en bonne place dans les promesses électorales des partis. Dans cette année préélectorale, tous les partis vont se découvrir un nouvel intérêt pour la justice sociale. En ce sens, le débat sur la justice sociale peut contribuer, dans une certaine mesure, à un sursaut éthique, et poser un jalon dans la moralisation du système économique.
La justice sociale, notion protéiforme, comporte en effet de nombreuses dimensions. Pour les uns, elle est entendue comme la satisfaction minimale des besoins et présuppose un minimum de solidarité avec les plus mal lotis. Les représentations de ce minimum varient d’un parti à l’autre et vont, d’un extrême à l’autre, de la revendication d’une allocation universelle, accordée à chaque citoyen sans contrepartie, à une réduction des prestations sociales existantes. Pour d’autres, elle est entendue comme une justice distributive qui s’attache à corriger les inégalités de la répartition primaire assurée par le marché, en introduisant une redistribution verticale du revenu par l’État, qui prend aux plus riches pour donner aux plus pauvres, essentiellement par la fiscalité directe, à travers la progressivité de l’impôt sur le revenu.
La justice sociale sert aujourd’hui de référence autant aux partis d’inspiration libérale, quand ils entendent lutter contre le « trop d’État » et le poids de la fiscalité, qu’aux partis d’inspiration socialiste et islamiste quand ils veulent protéger l’individu contre les risques existentiels. La relation liberté-égalité constitue le fondement de la justice sociale. Les discours de tous les partis politiques se réfèrent aux mêmes valeurs de liberté, de solidarité et de justice. Elles découlent chez les uns des valeurs religieuses, d’autres de la pensée libérale, d’autres, enfin, de l’idéologie socialiste dans ses différentes acceptions.
Les différences constatées dans la hiérarchie respective de ces valeurs, dans les déclarations programmatiques permettent de révéler l’identité politique des uns et des autres. La liberté, toujours citée en premier, chez les partis qui se réclament du libéralisme, l’est en relation avec l’égalité chez les mouvements d’obédience socialiste, en relation avec la justice chez les partis d’inspiration religieuse. Pour les uns, la solidarité émane de la nature sociale de l’homme et de l’impératif de l’amour du prochain. Pour les autres, la solidarité, obligatoirement réciproque, entre les forts et les faibles débouche sur des obligations et pas seulement sur des devoirs. Pour d’autres, enfin, l’égalité devant la loi et l’égalité des chances imposent qu’il y ait une plus grande égalité dans la répartition des revenus, de la fortune et du pouvoir. L’accent mis ici sur la liberté, là sur l’égalité, et une conception différente de la solidarité permet de comprendre les différences dans la conception de la justice sociale dans les différents courants politiques.
Ces différences, perceptibles dans les discours politiques ou les programmes électoraux, s’estompent dans la gestion des politiques sociales quand ces partis accèdent à la gestion de la chose publique. C’est pour cette raison que le renouvellement de la question de la justice sociale se repose avec acuité aujourd’hui, où le citoyen doute de l’efficacité des politiques publiques à endiguer les inégalités. Le débat national sur l’égalité est trop souvent subordonné à de fortes bouffées de demandes d’égalité que le système politique est sporadiquement obligé de prendre en compte sans avoir le temps de les traiter correctement sur une longue durée, ce qui aboutit à des déceptions. À l’évidence, s’il est un problème qui doit être traité en continu et sur le long terme, c’est bien celui-là. Cette réflexion est nécessaire pour la conduite de nos politiques de transferts sociaux, de répartition au sein des entreprises et nos politiques sociales.
Nous avons besoin de critères suffisamment clairs et opérationnels pour départager les inégalités acceptables ou justifiables de celles qui ne le sont pas, afin d’orienter l’action. Où trouver ces bons repères et à partir de quel principe ? Convient-il de se référer à un principe unique de justice (ou à un petit nombre de principes), qui pourra prétendre à l’universalité, mais aura nécessairement un caractère fortement abstrait ? Ou bien à des principes variables selon la nature des biens en cause. Cette réflexion sur les principes de justice est doublement nécessaire. Elle l’est, d’abord, économiquement, car, pour définir correctement les politiques publiques nous avons besoin d’une pensée claire sur les questions d’égalité et de justice, qui constituent des aspects fondamentaux de ces politiques. Elle l’est, ensuite, politiquement, car elle constitue une exigence de la démocratie : pour bien fonctionner, celle-ci a besoin de principes régulateurs des conflits et de mécanismes de prévoyance sociale efficients.
La difficulté de concevoir et d’appliquer ces principes conduit naturellement à approfondir la réflexion sur les liens existants entre justice sociale et liberté. Certes, la liberté est la reconnaissance et la sauvegarde de la possibilité d’initiative, du droit d’entreprendre quelque chose, dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Mais certains utilisent la liberté du marché pour prélever, à travers le profit normal d’entreprise, un « super impôt privé » qui n’est que le droit du plus fort. C’est à la collectivité par la loi de les en empêcher ; ou d’en prendre une part. Une société démocratique n’est pas une société uniforme sinon elle engendre l’ennui, le fatalisme, la démission. C’est pourquoi un système social fondé sur l’égalité n’est pas incompatible avec des différences de situation. Mais ces différences doivent être motivées (par les dons naturels, le mérite, les efforts, le travail). Et ces différences doivent être une œuvre, c’est-à-dire le résultat de l’action du sujet.
Regards sur des aspects de la justice sociale au Maroc
Le lien entre justice sociale et justice spatiale est parmi les thèmes les plus discutés de la justice sociale au Maroc. Une lecture de la dimension territoriale de la justice sociale renseigne sur la difficulté de traduire les principes de la justice et l’égalité dans les politiques publiques.
L’observation des disparités spatiales révèle que le Maroc connaît de fortes inégalités socio-économiques, créant des ruptures entre les régions, entre la ville et la campagne et entre villes. D’importantes disparités persistent entre les douze régions qui composent son territoire. En effet, le territoire national est caractérisé par une concentration démographique et économique le long du littoral atlantique et des clivages entre la région centre et les régions périphériques, d’une part, et, d’autre part, entre les régions fortement urbanisées et les régions agricoles. Ces disparités concernent à la fois la croissance démographique, la dynamique économique et les secteurs sociaux. Leur évolution est déterminée principalement par trois facteurs : l’urbanisation, les migrations et la localisation des activités.
Ainsi, les disparités régionales en termes de population se sont creusées. La répartition de la population sur l’ensemble du territoire a connu des changements perceptibles. La distribution spatiale de la population et la structure de l’habitat qui en découle contribuent à déterminer la qualité de vie tant pour les citadins vivant à proximité de zones rurales que pour les personnes résidant en milieu rural et ayant facilement accès aux services. La création de richesses reste très inégale et les disparités se sont même accrues (les activités industrielles restent concentrées sur le littoral d’El Jadida à Kenitra).
L’égalité des territoires n’est « ni innée ni spontanée ». Les territoires sont par nature inégaux et le jeu du marché, combiné à celui des politiques publiques, tend à les rendre plus inégaux encore. Réfléchir à l’égalité des territoires suppose de penser l’articulation entre justice sociale et justice spatiale, entre égalité des personnes et égalité des territoires. Les inégalités des territoires, tant l’inégalité est en la matière plurielle et les inégalités souvent cumulatives. Il importe de les connaître si on veut les combattre. Car ces inégalités entre territoires se traduisent par des inégalités de parcours sociaux et « de destin entre citoyen(ne)s, des inégalités sociales persistantes du fait du territoire ».
L’égalité des territoires n’est pas, non plus, univoque. Il est nécessaire de préciser au moyen de quelle conception de la justice on entend promouvoir et construire l’égalité des territoires. Il est difficile de viser l’égalisation des espaces : les conditions naturelles, les préférences collectives des habitant(e)s, la liberté de se déplacer, la spécialisation territoriale, les stratégies différenciées de développement local, l’insertion mondiale relèvent de contraintes et de choix sur lesquels il est très complexe de vouloir agir. Un second aspect de la justice territoriale renvoie à la compétitivité des territoires par laquelle des territoires cherchent à valoriser leur potentiel mais aussi à attirer les ressources et à mieux se positionner par rapport à d’autres territoires. Cette compétition se double d’une concurrence pour les ressources humaines et les ressources publiques. La compétitivité et l’attractivité territoriales ne doivent pas être comprises dans un sens étroitement économiste : la valeur et la force d’attraction des territoires dépendent de manière capitale, matricielle, de la qualité de leurs infrastructures et de leurs services publics, capital institutionnel qui fait une part essentielle de la « compétitivité » nationale au plan mondial.
L’égalité des territoires ne se limite pas à l’égalité entre les territoires. C’est plus justement l’égalité dans les territoires. L’égalité des collectivités territoriales, qui ne connaît pas de définition juridique précise, repose en fait sur l’idée d’une « égalité médiate », « d’une égalité dans la protection des libertés des personnes sur l’ensemble des territoires » qui suppose à l’égard des collectivités territoriales à la fois « uniformité du statut » et « respect (ou prise en compte) des différences ». [2] Le principe d’égalité des collectivités territoriales se justifie par le « souci de préserver une application uniforme des droits fondamentaux sur l’ensemble du territoire national ».
Cette problématique est essentielle : réfléchir à l’égalité des territoires suppose de penser l’articulation entre justice sociale et justice spatiale, entre égalité des personnes et égalité des territoires. L’égalité des territoires peut en effet s’interpréter comme l’explicitation du fondement éthique du projet d’aménagement du territoire, c’est-à-dire la recherche dans le cadre géographique du territoire national, d’une meilleure répartition des hommes, en fonction des ressources naturelles et des activités économiques. Cette recherche est faite dans la constante préoccupation de donner aux populations de meilleures conditions d’habitat, de travail, de plus grandes facilités de loisirs et de culture. Cette recherche n’est donc pas faite à des fins strictement économiques, mais bien davantage pour le bien‑être et l’épanouissement de la population. C’est bien « un principe de justice (et de bien‑être) qui est réaffirmé comme supérieur au seul principe d’efficacité territoriale ou d’optimisation économique de l’espace national ».
Cette approche de la question de l’égalité/inégalité des territoires qui mobilise le concept de justice spatiale/justice sociale ouvre un large champs de réflexion sur les types de politiques publiques susceptibles de concourir à l’égalité des territoires et permet d’introduire dans la réflexion, en sus du mécanisme de la péréquation des ressources financières, les questions de l’investissement public en tant que vecteur de dotation équilibrée et harmonieuse des territoires en infrastructures et équipements, préalable à l’accessibilité des personnes aux droits économiques et sociaux. Les territoires sont par nature inégaux et le jeu du marché, combiné à celui de politiques publiques inappropriées, tend à les rendre plus inégaux encore. Il est nécessaire de préciser au moyen de quelle conception de la justice entre personnes on entend promouvoir et construire l’égalité des territoires.
On peut difficilement viser l’égalisation des espaces : les conditions naturelles, les préférences collectives des habitant(e)s, la liberté de se déplacer, la spécialisation territoriale, les stratégies différenciées de développement local, l’insertion mondiale relèvent de contraintes et de choix sur lesquels il est à la fois très complexe et peu légitime de vouloir agir. Les ressources de la puissance publique étant aujourd’hui particulièrement rares et précieuses, mieux vaut ne pas dilapider ses moyens à poursuivre la chimère d’une maîtrise illusoire, d’en haut, sur les territoires. Mais l’égalité des territoires a bien un sens: elle s’apparente à la continuité territoriale du service public, promise à chaque citoyen(ne) par la Constitution. Elle pourrait signifier, au moyen d’une égalité plurielle et d’une justice dynamique[3], la promotion du développement humain et des capacités de toutes et tous, quelle que soit sa position dans l’espace physique et social.
Le principe d’égalité des territoires se justifie par le « souci de préserver une application uniforme des droits fondamentaux sur l’ensemble du territoire national ». Réfléchir à l’égalité des territoires suppose de penser l’articulation entre justice sociale et justice spatiale, entre égalité des personnes et égalité des territoires. L’égalité des territoires peut en effet s’interpréter comme l’explicitation du fondement éthique du projet d’aménagement du territoire L’égalité des territoires peut en effet s’interpréter comme l’explicitation du fondement éthique du projet d’aménagement du territoire. constante préoccupation de donner aux hommes de meilleures conditions d’habitat, de travail, de plus grandes facilités de loisirs et de culture.
Justice sociale et politique publique : l’ascenseur social est-il en panne ?
La mobilité sociale est une forme d’expression d’une justice sociale en mouvement. Cette mobilité progresse au Maroc, même si les indicateurs utilisés masquent les effets de la crise pour les plus jeunes. Ceci dit, une société peut être très mobile mais aussi très inégalitaire. Dans le Maroc d'aujourd'hui, l'idéal méritocratique - l'égalité des chances promise à tous - est un élément essentiel du consensus social. En donnant à penser que chacun a sa chance, la société contribue à rendre légitime la hiérarchie sociale, pourtant marquée par de fortes inégalités. Or, en pratique, l'accès aux positions sociales, qui détermine revenus, consommation et modes de vie, est tout sauf égalitaire. Au premier abord, la société marocaine semble de plus en plus mobile.
En 1960, le Maroc comptait combien de cadres fils d’ouvriers ou de paysans pauvres ? 1% ou 2% tout au plus. Actuellement, ils sont certainement plus à l'être. La proportion de fils qui ont dépassé la position sociale de leur père a probablement connu une évolution notable en cinquante ans. Mais de quelle mobilité s'agit-il ? Les classiques approches de la mobilité mesurent autant les transformations de l'emploi (la mobilité dite structurelle) que l'ascension (ou la descente) des individus (la fluidité, ou mobilité nette). En fait, la proportion de fils d'ouvriers devenus cadres n’a pas suivi le développement de la part des cadres parmi les actifs. Car, l'essor de l’industrie ou des secteurs modernes des services n’a profité qu’à peu d’emplois qualifiés.
À l'inverse, la poursuite du déclin de l'emploi agricole entraîne mécaniquement un effet de mobilité. C’est probablement plus les « petits métiers » du tertiaire qui ont absorbé les mouvements humains de redéploiement spatial et social. Évaluer l'évolution de la fluidité de notre société n'est pas simple. Comment estimer ce qui se serait passé si la structure sociale n'avait pas changé ? Car les frontières entre catégories se modifient. En outre, leur hiérarchie est difficile à définir : à partir de quels critères peut-on dire qu'une catégorie est au-dessus ou au-dessous d'une autre ? Le revenu n'y suffit pas, et la notion de qualification devient toujours plus difficile à établir avec les mutations de la structure de l'emploi.
Les analyses de la mobilité n'apportent d'enseignement que sur longue période. On observe le devenir de personnes insérées dans l'univers professionnel depuis assez longtemps pour que leur position sociale puisse être considérée comme stable. Passés 40 ans, les choses ne se modifient plus radicalement et on étudie donc la situation de ceux qui ont passé ce cap par rapport à celle de leur père au même âge. La situation sociale des plus jeunes n'est pas prise en compte. Or, aujourd'hui, ce sont précisément les moins de 40 ans qui paient le plus lourd tribut à la crise de l'emploi et risquent le déclassement.
La mobilité classique ne mesure pas l'évolution de la mobilité de la société dans sa globalité, mais de certaines générations seulement. Force est de constater que, si l'on prend en compte les générations les plus récentes, cet accroissement de la fluidité est beaucoup moins clair. La crise de l'emploi a laissé une marque profonde chez les générations entrées au cours des dernières années sur le marché du travail. La désillusion a été énorme pour une partie des parents des classes moyennes, souvent issus du processus de mobilité ascendante des premières décennies de l’indépendance, qui ont vu leurs enfants - en qui ils avaient fortement investi psychologiquement et financièrement - peiner pour s'insérer dans le monde du travail. Au bout de l'allongement des scolarités, les débouchés n'ont pas toujours été au rendez-vous, apparaissant souvent sans rapport avec les efforts accomplis. Même si l'école s'est en partie démocratisée, la compétition s'est accrue et ce sont les enfants des catégories supérieures qui s'en sortent le mieux.
Les promotions de lauréats des universités marquées par la crise du système éducatif et de débouchés dépassent déjà la quarantaine ; elles sont sur le marché du travail depuis de longues années, sont parfois même considérées comme « âgées « et ont donc peu de chances de voir leur position sociale progresser beaucoup... Quant aux nouvelles créations d'emplois, elles s'opèrent moins dans des postes de haut niveau que dans des postes peu qualifiés, avec peu d'espoir pour ces derniers de réaliser une vraie carrière.
La société se transforme, les identifications traditionnelles (la tribu, la bourgeoisie, la classe ouvrière etc.) se brouillent, mais les hiérarchies sociales, même recomposées existent toujours. Le capital économique concret (l'argent), le capital symbolique (le Jah) continuent de marquer la reproduction sociale et du pouvoir. Le capital culturel (le diplôme), plus complexe, n'a pas radicalement bouleversé la structure de notre société. L'école n'est pas seule en cause : la rigidité des parcours professionnels est aussi l'un des grands facteurs d'immobilisme. Les entreprises consacrent peu d'investissements à la formation continue. Enfin, la fluidité peut servir de paravent au maintien d'inégalités sociales fortes. Une société peut être très mobile et inégalitaire. Battre mieux les cartes à chaque génération n'est pas suffisant si les stratifications sociales elles-mêmes ne sont pas remises en cause. Le coeur du progrès vers plus d'égalité est bien dans le rapprochement des conditions, pas dans la rotation des élites.
Conclusion
En dépit de la mobilité sociale constatée, il n’en reste pas moins que l’histoire du Maroc et d’autres pays nous montre une foule de ruses et d’entorses aux principes de l’égalité, de la liberté, de la justice, de la responsabilité et des droits. Ce qui, dans l’éthique individuelle, peut s’expliquer en termes de pulsions, d’aspirations ou d’idéal, reste alourdi, au niveau collectif, par la somme impressionnante d’utilités ou de nuisances réciproques, d’intérêts antagonistes. Le mouvement de notre société est confronté à des résistances à l’application des principes de l’égalité, de la liberté, de la responsabilité et de la justice.
Résultat du parcours : l’ancrage dans les perceptions de la population que deux sociétés coexistent : une dont les membres jouissent de l’égalité des droits, des initiatives et des récompenses ; une autre où, indistinctement, les individus ne sont égaux que dans la privation des droits ouverts aux autres. On dira que cette perception est teintée de subjectivisme, mais il n’empêche qu’elle imprègne le comportement d’une fraction de la population dans ses rapports à autrui, sinon même à l’État.[4]
Aujourd’hui, la solidarité collective exige de rénover le système de protection sociale. Deux faits nouveaux au moins doivent être nécessairement pris en compte dans la configuration du système. D’un côté, l’environnement international pèse sur la situation nationale et sur chaque principe de l’organisation sociale. Ainsi, le revenu, l’emploi, la protection sociale sont exposés à la menace des dangers du marché ; les accumulations de capital, de pouvoir économique sont un potentiel d’inégalité. De l’autre, face à la complexité de la vie collective, nulle société ne peut s’affirmer démocratique si elle n’organise pas un minimum de solidarité collective. Aussi, les politiques publiques doivent y veiller en revisitant les principes de liberté, de justice, de responsabilité et d’égalité des droits. Elles doivent pouvoir en faciliter la déclinaison par des mécanismes et lois suffisamment pertinents pour en assurer l’application effective. La vérité est qu’il n’y a pas de formule théorique et miracle. La volonté politique concrète, seule, peut garantir et faire vivre une société démocratique et juste
C’est pour cette raison que le renouvellement de la question de la justice sociale se repose avec acuité aujourd’hui, où le citoyen doute de l’efficacité des politiques publiques à endiguer les inégalités. La difficulté de concevoir et d’appliquer ces principes conduit naturellement à approfondir la réflexion sur les liens existants entre justice sociale et liberté. Égalité, liberté, justice, responsabilité, droits… Ces références sont inscrites normalement et, pour ainsi dire, forcément dans notre Constitution. Leur usage répété dans les discours politiques, les expose à l’érosion. Il faut donc les réinterpréter à l’aune de la réalité, les vivifier, les redéfinir pour que leur insertion dans l’architecture constitutionnelle d’une organisation collective ne soit pas de pure forme. C’est que la noblesse de ces principes semble avoir une vertu inépuisable. Pourquoi ? Si l’on se place sous le signe de la morale politique, la réponse est aisée : ces valeurs supérieures s’imposent et ne se discutent pas. Car elles incarnent dans la grande histoire des sociétés humaines, le versant du BIEN.
Bibliographie
Dubert, F. (2014) Inégalités et justice sociale. La Découverte, 2014, Paris.
Rawl, J. (1997), Théorie de la justice, Points, Essais, 1997 ; Paris.
Paugan, S. (2011), Repenser la solidarité, PUF, Paris.
Sen, A. (2012), Repenser l’inégalité, Points, Économie, Paris.
Sen, A. (2008), Une politique de la liberté, Éditions Michalon, Le bien commun, 2008, Paris.
[1] A. Sen : Nouveau modèle économique. Éditions Jacob. Paris, p 13.
[2] Rapport : Vers l’égalité des territoires. Dynamiques, mesures, politiques. Dirigé par Eloi Laurent
[3] Il est trop réducteur d’évaluer de manière statique la position des territoires par leur « écart à la moyenne » sans considérer leurs trajectoires de développement (ou de décrochage)
[4] Il faut relever que même dans les démocraties les plus avancées, cette déformation dans la perception de l’égalité des droits n’est pas mince, et concerne d’ailleurs des droits inscrits dans les textes constitutionnels. C’est elle qui fait dire à l’humoriste Michel Colucci dit Coluche que : «Les hommes naissent libres et égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres » .