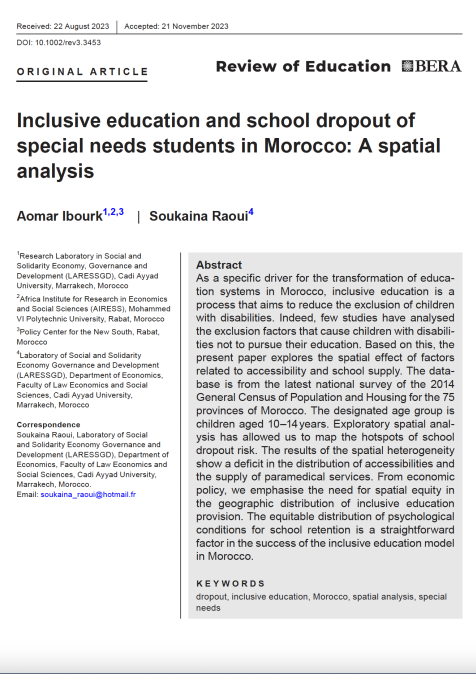Publications /
Policy Brief
Interroger le lien entre le Maroc et son continent d’appartenance, l’Afrique, à partir de l’entrée des Industries culturelles et créatives (ICC), nous met d’emblée devant la nécessité d’interroger autant les concepts que les contextes d’où elles sont énoncées. Il nous oblige, par souci de rigueur et de justesse, de souligner les paradoxes qui les sous-tendent. Car par-delà l’appartenance géographique, des (dis)continuités historiques et culturelles, l’africanité du Maroc est l’objet de plus en plus manifeste d’une posture (géo)politique. Dans celle-ci, se mêlent le besoin de relire son passé impérial, par-delà les barrières sahariennes dressées par le protectorat, le rapport actuel à l’Europe et à la migration subsaharienne, le retour à l’Union africaine (UA) pour mieux défendre les intérêts de souveraineté territoriale et les interdépendances économiques, et le réinvestissement de liens ancestraux avec le continent dans un souci d’élargissement du soft power régional du Maroc au regard de partenaires plus puissants.
Si la relation à l’Afrique est aussi complexe et empreinte d’ambiguïtés à élucider, le rapport au concept assez récent d’industries culturelles et son extension vers les industries créatives soulève une autre série de questions, sur la manière avec laquelle il a été transplanté ou greffé dans des contextes africains, bien moins développés que ceux, américain et européen, où il a été élaboré. Quoique fortement internationalisée par les organisations non gouvernementales (ONG) à propension culturelle et économique, mais aussi par les coopérations bilatérales, l’économie de la culture n’en demeure pas moins, au Maroc comme dans plusieurs autres contrées d’Afrique, balbutiante, surestimée, appliquée à des réalités endogènes, informelles, échappant aux classements standardisés.
Il importe à ce niveau de saisir, en amont, les transferts qui se sont opérés historiquement, de l’industrialisation de la culture comme phénomène appréhendé à partir d’un appareillage critique, aux « industries » dites culturelles, puis créatives, abordées comme catégories d’analyse et de classement des activités productives du symbolique, de ses acteurs et chaînes de valeur. Il importe, dans le même sillage, de saisir les formes d’interaction et les liens culturels entre le Maroc et son continent et de quoi ils sont révélateurs, en termes de complémentarités, de rapports de force et d’intérêts. Dans quels contextes socio- historiques se situent-ils ? Quelles résistances et réticences leur relance produit-elle ? Et quelles brèches possibles ouvre-t-elle ?
Histoire non écrite d’un chassé-croisé
L’histoire des liens culturels entre le Maroc et son continent n’est pas écrite. Elle est enchâssée dans des écrits historiques sur les relations commerciales, sur les caravanes spirituelles et marchandes du Sud, sur les lieux de passage réputés (ex : Maison d’Iligh, Route de Sijelmassa ...) et sur les relations à la traite négrière et à une forme de ségrégation et de bannissement du « Noir » socialement normalisée.1 Nul besoin, dans le cadre de cette analyse, de détailler ce qui sous-tend la dominance politique et économique de l’empire chérifien comme interactions symboliques. Il convient, en revanche, de signaler la rupture qu’il y a eu avec les tentatives d’artistes et écrivains, dès la fin des années 1960, essentiellement à travers les revues Souffles et Lamalif, de décoloniser le regard sur la culture et jeter les ponts avec l’Afrique dans le souci d’appréhender nos apports à une culture- monde. Une série de facteurs a contribué à l’occultation de ces efforts. Le surinvestissement de l’identité arabo-musulmane, le déni du passé esclavagiste du Maroc, la marginalisation de voix élevées dès les années 1980, attentives aux appartenances diverses et conflictuelles d’un Maroc pluriel2, ont tous contribué à escamoter l’africanité du Maroc pendant au moins trois décennies après l’indépendance.
Il serait fallacieux de croire que la conscience de cette dimension socio-historique était alors complètement absente. Il est possible, pour s’en convaincre, d’évoquer des contributions singulières, comme celle de l’artiste-poète Mohamed Kacimi, dont « la maturité artistique s’épanouit totalement au moment où elle s’accorde avec la prise de conscience de son africanité »3, celles d’écrivains et penseurs comme Abdelkébir Khatibi et Edmond Amran El Maleh, particulièrement soucieux de penser la pluralité, ou bien les travaux de cinéastes, comme Mostafa Derkaoui et Ahmed Bouanani, particulièrement attentifs à la diversité ethnique de leur société et le besoin urgent qu’ils y ressentent de décoloniser les formes et les imaginaires. À tout cela s’ajoute l’ancrage des rythmes de la musique gnaouie et autres chants folkloriques, largement déclassés ou exotisés, dans une cosmogonie africaine.
À vrai dire, le remembrement symbolique du Maroc avec son continent d’appartenance, d’un point de vue institutionnel et discursif, en plus d’être retardé par le protectorat, a été longtemps repoussé par des élites postcoloniales, fortement occidentalisées et/ ou orientalisées. Il a fallu attendre le milieu des années 1990 et, surtout, le changement de règne pour voir émerger culturellement des manifestations qui attestent de ce lent regain d’intérêt pour la profondeur africaine du Maroc, qu’il ne faut pas dissocier de la réhabilitation de la composante amazighe essentielle dans la reconfiguration identitaire de la nation. Afin de saisir le sens de ce changement de cap, à partir des secteurs d’activités culturelles, citons trois festivals phares : la renaissance du Festival du cinéma africain à Khouribga, en 1994, le lancement du festival Gnawa et les musiques du monde à Essaouira, en 2000, et celui des Musiques sacrées à Fès en 1998.
Il convient, tout d’abord, de noter la teinte religieuse, dans le sens populaire du terme, en lien avec les pratiques de soufisme confrérique qui est en toile de fond des deux festivals de musique les plus réputés, d’Essaouira et de Fès. Le fait que cette dimension soit mise en avant dans la fabrique des deux événements fait écho au discours de diplomatie culturelle, que le Maroc affiche comme déterminant en lien avec l’Afrique, et qui insiste avant tout sur « les relations ancestrales et spirituelles ».4 Dans le festival d’Essaouira, le lien de la pratique artistique avec les formes de rituels qui l’accompagnent (la lila, les offrandes, etc.) rappelle constamment la culture païenne, animiste, africaine où elle est historiquement ancrée, et la longue voie de réislamisation des imaginaires populaires qui l’accompagne. Par ailleurs, cela implique, du côté des musiques sacrées et autres festivals musicaux à obédience mystique, un investissement des liens avec les tariqa, tijanie, par exemple, dans l’Ouest africain. L’argument avancé pour favoriser le tourisme culturel est celui du Maroc comme phare civilisationnel au Nord de l’Afrique par le biais de la musique.
La deuxième remarque qui se dégage des trois festivals susmentionnés est la force du réseau davantage interpersonnel, tissé par les dirigeants et directeurs artistiques avec leurs pairs du continent, en triangulation avec l’Europe. Que ce soit à travers le Fespaco, plus important festival africain de cinéma à Ouagadougou, ou les Festivals de Carthage ou du Caire, la figure de proue du festival de Khouribga, le regretté Noureddine Saïl, a forgé durant des années un réel ancrage continental, philosophiquement soutenu par une vision tournée vers les esthétiques du Sud. Côté musique, le choix délibéré de directeurs artistiques maghrébins de la diaspora, comme Karim Zyad, à Essaouira, a également contribué à renforcer l’attraction d’artistes du continent, repérés à travers les circuits internationaux. Au fond, l’Afrique qui vient au Maroc dans ces cadres-là est celle d’artistes reconnus, identifiés ailleurs par des connecteurs avisés.
Il y a eu, en parallèle, du côté de la société civile et d’acteurs culturels indépendants, des initiatives qui cherchaient à relayer le Maroc à son africanité autrement, à travers le lien avec les Subsahariens qui y résident par défaut (de transit) ou par choix (d’études et de travail). Prenons l’exemple de la manifestation, Migrant scène et de l’organisation associative, Afrikayna. Quoique menées en partenariat avec des structures ayant pignon sur rue au Maroc, les deux sont demeurées à rayonnement limité quand elles n’ont pas subi les effets de la précarité de leur financement, tributaire de donateurs nationaux et internationaux.
Ainsi, en faisant un bref bilan des dix dernières années, le lien culturel avec le continent demeure essentiellement porté par une logique d’affichage et de show casing au Maroc. C’est le cas du festival Visa for music, créé en 2014, et qui a mis en avant la ville de Rabat, comme porte du marché africain mais aussi comme lieu de passage pour s’en exporter. En 2017, l’exposition abritée par le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, sur L’Afrique en capitale, s’est également voulue un événement multidisciplinaire, célébrant par les œuvres symboliques, le retour du Maroc à l’UA. Créé la même année, le Salon du livre maghrébin à Oujda a entrepris d’intégrer régulièrement des invités subsahariens (Sénégal, Cameroun...) dans le but de créer, à partir de la capitale de l’Oriental, un club d’éditeurs reliant les Afriques, du Nord et de l’Ouest. Dernière initiative en date, l’événement livresque, Littératures itinérantes, en octobre 2022, à Fès, a été centré sur l’Afrique, avec invitation d’une quinzaine parmi les 40 auteurs conviés, de contrées africaines (Algérie, Egypte, Soudan, Mauritanie, Djibouti, Sénégal).
L’enjeu pour le Maroc, culturellement, même si les artistes et producteurs ne sont pas tous de cet avis, est moins d’être une simple partie prenante de dynamiques exogènes favorisées par des financements européens (Biennale d’Art de Dakar, Fespaco, etc.) que de créer des rendez-vous lui permettant d’afficher son africanité chez lui. Le Maroc se met ainsi en scène comme le représentant, voire le parangon, de son continent à partir de ses propres terres.
Un «concept voyageur» transplanté
Le caractère épisodique, évènementiel, ni permanent ni largement reproduit des activités culturelles attestant des liens entre le Maroc et son continent, nous oblige à en caractériser la nature. S’agit-il d’ICC ? D’où vient ce concept ? De quelles réalités technologiques, sociales et économiques rend-il compte ? Et quel sens lui donner lorsqu’il se transmue en concept voyageur, adopté par des experts pour nommer d’autres réalités, comme la nôtre ?
Il n’est pas inutile de rappeler que l’industrie culturelle (au singulier) est un concept forgé en 1944 par deux philosophes de l’école de Francfort exilés aux États-Unis, Max Horkheimer et Theodor Adorno. Dans leur article inaugural5, fortement imprégné de théorie critique marxiste, ils partent des usages de la culture de masse, par le cinéma, la télévision, l’opéra, le théâtre, et autres médias de divertissement, afin de désigner par le terme « industrie » la marchandisation, consommation et mélancolique banalisation des œuvres d’art par leur reproduction.
Au début des années 1970, alors que le débat post-colonial sur la diversité culturelle commence à poindre, un autre philosophe appartenant à la même école de pensée, Walter Benjamin, expliquera dans un article tout aussi fondateur6, comment en Occident la reproductibilité technique des œuvres culturelles et artistiques leur ôte tout caractère auratique. Il développe alors une conception mélancolique de l’industrialisation de la culture. Il importe, alors, de noter qu’au Maroc, comme dans le reste de l’Afrique, où plusieurs formes artistiques (cinématographiques, musicales, performatives), à l’époque classées ailleurs (aux États-Unis surtout) sous le label des industries culturelles, étaient encore naissantes, en quête de singularité, d’une sève créatrice et de résonance culturelle avec leur lieu d’ancrage, bien plus que leur transformation en produits de consommation de masse.
La globalisation du concept des industries culturelles est le fait notoire du congrès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) tenu à Mexico en 1982. Comme l’explique le chercheur en médias, Armand Mattelart, c’est bien la conjonction de culture de masse et communication de masse qui a accéléré l’adoption de la notion d’industrie culturelle comme entrée pour quantifier économiquement et mieux valoriser par les politiques culturelles l’apport des productions symboliques.7 Le débat enclenché, plus tard, toujours à partir de l’instance onusienne jusqu’à la formulation en 2005 de la Convention relative à la diversité culturelle -notion venue suppléer celle de l’exception cultuelle-, a créé le cadre adéquat pour globaliser les industries culturelles au nom de la diversité des formes d’expression et des activités économiques basées sur l’art, la culture et les médias. Du même tenant, une série de coopérations et d’aides aux pays africains en lien avec le patrimoine ou les secteurs audiovisuel et musical a favorisé la transplantation de ce concept voyageur, et l’élaboration à partir de la notion de « développement »8 d’un cadre de coopération culturelle étendu. Ceci fut particulièrement le cas avec l’Union européenne (UE), à travers les programmes conçus pour le soutien aux industries culturelles dans les aires géographiques tierces, labellisées Afrique-Caraïbe-Pacifique (ACP).
Si cet effort politique est consenti pour mondialiser la notion d’industries culturelles, il importe de noter que, depuis les années 1990, sous l’effet conjugué du gouvernement Tony Blair, attentif à l’émergence de classes créatives urbaines, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de publicistes, économistes de la culture et de l’aménagement des territoires, la palette des secteurs a été élargie pour englober les « industries créatives ». Mais, dans son document de référence datant de 2012 à l’adresse des espaces extra-européens, l’Unesco semble avoir exhumé un vieux modèle européen, datant des années 1970, favorisant la centralité de l’État et l’encadrement administratif public, de secteurs créatifs.9 Du coup, même si en Europe, les technologies d’information et de communication (TIC) et par effet de ricochet les médias, ont dès lors refaçonné la catégorie des ICC, en Afrique, note Bernard Miège, « les industries créatives ont été quasiment réduites aux industries culturelles (livre, musique, cinéma et audiovisuel), hormis l’artisanat d’art (relié au tourisme) ou la mode ».10
En adaptant le modèle à chaque région, l’Unesco a joué sur cette base-là en Afrique, « les rôles d’accompagnateur, de prescripteur, de conseiller technique et même de prescripteur ».11 Ce qui permet davantage de coller à des grilles de financement et cadres d’analyse qu’à la maturation et à la réalité des activités elles-mêmes au sein des pays africains. Il est évident que, partant de ce cadre de dénomination, il existe au Maroc aujourd’hui une réalité productive, des structures d’appui et de plaidoyer en lien avec les Industries culturelles et créatives.12 Il existe même des stratégies partielles élaborées depuis peu par des relais de la coopération internationale, francophone essentiellement (française, belge, suisse, canadienne), attentifs au potentiel du Maroc comme « hub africain ». Ces derniers, quoique sceptiques sur la réalité du label, n’en demeurent pas moins aux aguets de toutes formes d’extension des marchés possibles pour leurs acteurs et structures créatives.
Entre temps, il importe de noter qu’au Maroc, par exemple, la transition rapide et faiblement pensée induite par ce changement de paradigme (la culture comme facteur de développement économique) crée des distorsions avec, d’un côté, une politique de subvention publique bancale, plus tirée par le besoin d’affichage quantitatif de l’offre que le souci d’élargissement de la demande (assez faible, du reste).13 D’un autre côté, ce tournant favorise essentiellement une logique business de la culture, qui la tire davantage vers le versant du divertissement. Du coup, cela ne permet pas d’embrasser les dynamiques informelles, artisanales, associatives, liées aux cultures populaires ou à des formes d’entrepreneuriat social, et révélatrices d’habitus social au sein de ces sociétés. Cela ne permet pas non plus, faute de culture démocratique, de favoriser la liberté de création et des dynamiques innovantes, qualifiées de subversives ou dissidentes, ou disqualifiées par un cadre réglementaire limitatif (autorisations préalables de tournage dans l’espace public, affectant des vidéastes, non reconnaissance des métiers culturels et créatifs dans les nomenclatures officielles, statistiques et administratives). Or, s’il y a des voies alternatives qui s’ouvrent pour permettre un remembrement culturel du Maroc avec son continent d’appartenance, il importe d’embrasser du regard l’ensemble des dynamiques à l’oeuvre.
Impensés et brèches contemporaines
L’élargissement du cadre des ICC et en même temps son inadéquation pour saisir les liens organiques entre création et recréation, nous invite dans le lien entre le Maroc et l’Afrique, à aborder quatre dimensions. La première, la moins visible, concerne le déploiement économique du Maroc dans le continent, à travers plusieurs secteurs (banques, assurances, télécommunications, BTP, engrais ...) et qui produit, en parallèle et en lien avec les représentations diplomatiques et consulaires, mais aussi les projets bilatéraux, un recours massif aux savoir-faire artisanaux (ébénisterie, maroquinerie, zellige, gastronomie, habillement, design ...). Ce volet, quoique profondément lié aux ICC, n’est ni appréhendé à partir de ce prisme ni compris comme potentiel créatif, vu son extrême patrimonialisation et son surinvestissement comme décorum et comme apparat de pouvoir symbolique impérial. Les acteurs-clés de ce pan d’activités sont davantage instrumentalisés comme faiseurs, exécuteurs, non comme porteurs d’un capital immatériel à réinventer.
Si ce premier volet est essentiellement révélé par la nouvelle politique d’expansion économique du royaume, le second est plus tôt éclairé par la nouvelle conscience décoloniale, insistant sur l’effacement de l’espace saharien, autrefois route commerciale florissante, comme point de jonction entre le Nord et l’Ouest de l’Afrique. Il importe, à cet effet, de noter l’émergence depuis une quinzaine d’années de festivals célébrant la culture nomade des Touaregs, à Taragalt au Niger ou à M’hamid El Ghizlane, au Maroc, où des groupes de musique mais aussi des porteurs de cultures locales transfrontalières sont chaque année mis au-devant de la scène, avec très peu de médiatisation et de valorisation. Il est nécessaire également de souligner l’initiative pionnière de l’association Afrikayna en 2019, d’aller sur les traces des Bambara, jusqu’au Oued Niger, pour commencer à reconstituer la route des Gnawas, comme un filon mémoriel, historique, musical, permettant de repenser l’esclavage, les rites, les rythmes et les oscillations d’un art de plus en plus voué à l’internationalisation depuis sa reconnaissance officielle par l’Unesco comme patrimoine immatériel.
L’autre volet sur lequel il importe d’insister, en prélude de projets de recherche plus approfondie sur la question, est le rôle des arts visuels. Dans le livre-catalogue, The Africans, conçu par le poète et curateur, Omar Berrada, en 2016, une place particulière est accordée à l’artiste marocain, M’barek Bouhchichi, qui a décidé de faire de la noirceur de sa peau le filon de sa recherche esthétique et éthique. En donnant à voir, par sculptures manuelles, croquis, schémas et autres dessins, la stratification sociale entre Haratins et Chorfas à Zagora, tout comme en exposant à l’Institut du monde arabe, l’ombre d’une moissonneuse batteuse qui symbolise la machine d’exploitation des blancs, il invite à repenser, à partir de la marge, du Sud, l’emplacement civilisationnel de son pays.
Sur un tout autre registre, médiatique, favorisant une culture de masse, musicalement métissée, il convient de souligner l’africanisation de la station Hit Radio. Avec cinq pays subsahariens, où elle a acquis des licences (Togo, Niger, Mali, Tchad et Congo Brazzaville), la radio joue le rôle de relais de la culture francophone. Puisque la primauté y est donnée à la langue française et à une dose de musiques et présentations en langues locales. Cela rappelle, tout comme dans le secteur de l’audiovisuel et du film soutenu par Euromed Audiovisuel, à quel point historiquement, dès les années 1990, la notion d’industries culturelles a été introduite dans le continent et au Maghreb par des agences puissantes comme l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).14
D’où l’intérêt de considérer, d’un point de vue structurel, l’initiative de l’association marocaine Racines pour la culture, dissoute par décision judiciaire en 2018, qui a tenté depuis 2012 de prendre part à l’organisation panafricaine Arterial network afin de penser en synergie avec d’autres acteurs du continent le développement des industries culturelles et créatives en Afrique. Le caractère isolé et éphémère de cette tentative pourrait aider à comprendre qu’entre le souci d’instrumentaliser la culture en Afrique par le soft power et le besoin d’articuler les dynamiques continentales, la tendance actuelle favorise le premier choix, sans que cela vienne changer la donne internationale, européenne, francophone en place.
En guise de conclusion
De tout ce panorama, esquissé à grands traits, il apparaît clairement que les ICC, comme catégorie, masquant des dynamiques et nommant d’autres, révèlent des intérêts et opportunités que des acteurs saisissent, mais aussi des tensions et manques qui sont faiblement pris en compte. Cet article est un prélude à des recherches ciblées à mener ultérieurement. Il souligne au moins trois pistes qui semblent dignes d’intérêt dans une perspective de compréhension des dynamiques en lien avec les ICC entre le Maroc et son continent. La première concerne le type d’activités mises en avant dans cette cartographie des relations. La deuxième concerne le jeu d’acteurs, nationaux et internationaux, derrière. Et la troisième, l’économie politique et la géo-économie qui sous-tendent ces embranchements.
1. Chouki El Hamel (2014), Black Morocco: A history of race, slavery and islam, Ed. Cambridge University Press.
2. Abdelkébir Khatibi (1983), Maghreb pluriel, Ed. Smer.
3. Nadine Descendre, commissaire de l’exposition « Kacimi – 1993-2003, une transition africaine », Mucem, Marseille, novembre 2018.
4. Ahmed Aydoun et Mohamed Kenbib (2015), La diplomatie culturelle marocaine. Proposition d’un modèle rénové, IRES, Rabat.
5. Max Horkheimer et Theodor W. Adorno (1974), La dialectique de la raison, Paris, Gallimard.
6. Walter Benjamin (2013), L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1939), traduit par Frédéric Joly, préface d’Antoine de Baecque, Paris, Payot, coll. Petite Bibliothèque Payot.
7. Armand Mattelart (2005), Diversité culturelle et mondialisation, Ed. La Découverte, Paris.
8. Patricio Jeretic (2009), Rapport final la culture facteur de développement économique et social, UE.
9. (http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf).
10. Bernard Miège (2016), « Industries créatives versus industries culturelles : quoi de nouveau ? quoi de différent ? » in Industries culturelles et entrepreneuriat au Maghreb ; (sous la dir. Abdelfettah Benchenna et Luc Pinhas), Ed. L’Harmattan, Paris (pp 21-36).