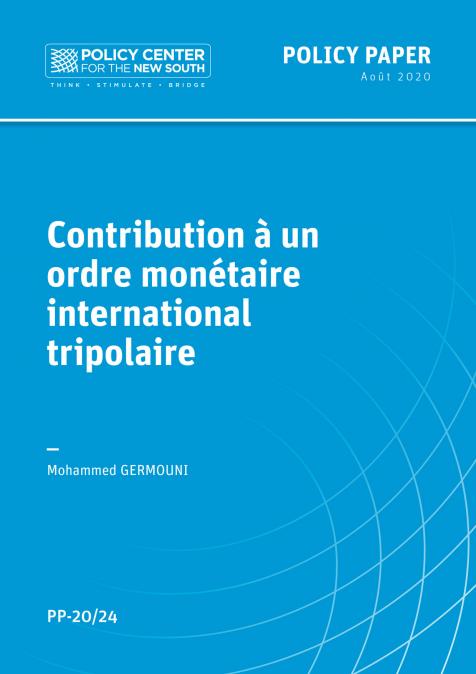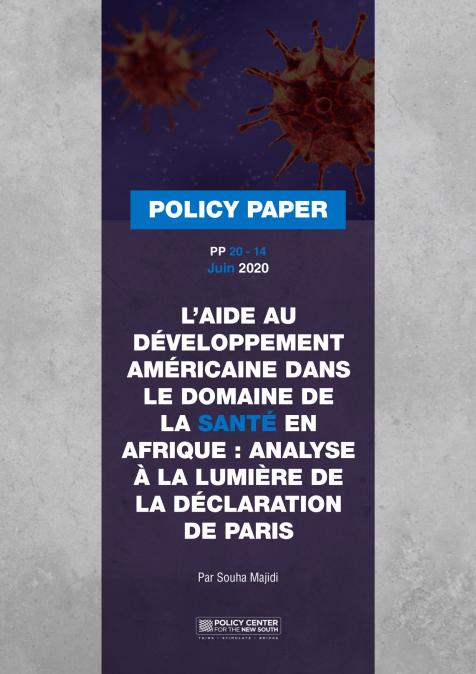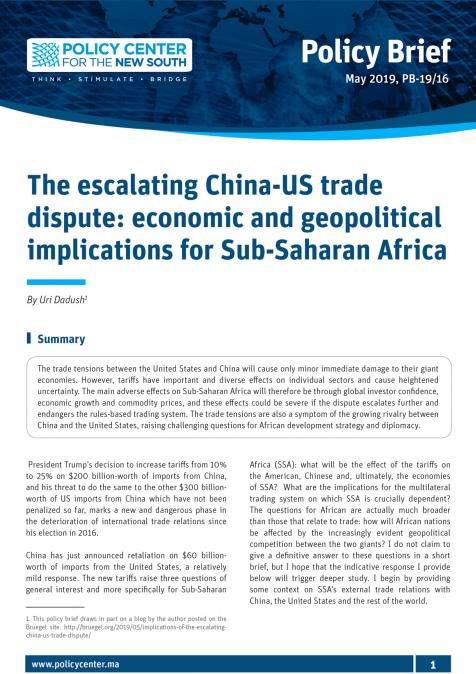Publications /
Opinion
Ce commentaire a été publié initialement sur commentaire.fr
La question du protectionnisme ne date pas du retour triomphal de Donald Trump, ni même de sa première élection : elle hante la mondialisation depuis le début du xxie siècle. Le nouveau programme du Président américain oblige toutefois à y réfléchir plus attentivement qu’on ne l’a fait jusqu’à présent. C’est l’objet de cet article.
Le retour triomphal de Donald Trump à la Maison blanche fait suite à une campagne caractérisée, entre autres, par un protectionnisme sans fard, revendiqué comme une stratégie gagnante et, de fait, électoralement payante.
C’est une composante du thème America First. Les proclamations protectionnistes s’inscrivent dans un isolationnisme affiché faisant l’impasse sur leur coût politique pour les Etats-Unis. A ces proclamations, il est tentant d’opposer des doutes sur la faisabilité du protectionnisme en ce deuxième quart du XXIème siècle.
La science économique et l’expérience sont l’une et l’autre formelles quant aux méfaits du protectionnisme : amputation du pouvoir d’achat, création de rentes, anémie de la productivité et de l’innovation, sans oublier l’enchaînement pernicieux des rétorsions…
De plus, l’approfondissement des échanges rend sa mise en œuvre malaisée. L’impact sur le pouvoir d’achat guette plus que jamais. L’arme est à double tranchant pour les industries à « protéger », devenues fortement tributaires, elles-mêmes, de composants importés. A cela s’ajoutent les obstacles juridiques dus aux règles de l’OMC et, si on les balaye, les représailles légales des partenaires lésés. D’aucuns en déduisent qu’il y a loin de la coupe aux lèvres.
C’est oublier deux éléments qui, désormais, conditionnent la politique commerciale :
- Le premier est le retour de balancier après le grand cycle libre-échangiste des décennies récentes. Les gains ont été considérables mais ils subissent la loi des rendements décroissants. Aujourd’hui, ils ne suffisent plus à balayer les oppositions que soulève – et a toujours soulevés – le libre-échange. Une forme d’épuisement historique frappe ce dernier. L’évolution des esprits, comme souvent, amplifie le tournant induit par les données objectives.
- Le second élément est l’utilisation de l’arme protectionniste à des fins, non plus économiques, mais politiques, ceci dans la logique transactionnelle étendue qui inspire désormais la politique étrangère des Etats-Unis.
Cette utilisation s’inscrit dans une politisation croissante des décisions économiques, observables depuis des années. La rivalité pour le leadership mondial entre les Etats-Unis et la Chine en est l’un des facteurs. Les facteurs identitaires en sont un autre. Ils ont fait irruption dans la vie politique intérieure de nombreux pays, expliquant en grande partie la vague populiste.
Après avoir goûté aux bienfaits du commerce international, les populations ne leur accordent plus la même valeur. Celle-ci n’est pas, pour autant, ramenée à zéro dans la réalité.
Ainsi, un vaste espace rhétorique s’ouvre au protectionnisme. Mais sa faisabilité réelle est plus restreinte, ce qui incite à scruter le rapport entre le discours et les actes.
A l’origine de la vague protectionniste : un double contre-choc
La mondialisation a déclenché deux contre-chocs distincts. L’un est dû à l’immense extension marchande qu’elle a provoquée. L’autre tient à la convergence politique qu’au contraire elle n’a pas engendrée. Ces deux éléments nourrissent l’un et l’autre le retour du protectionnisme.
1/ L’ampleur du retour de balancier après le grand cycle libre-échangiste
Entre le mitan des années 1980 et la crise financière de 2008, le commerce a connu une expansion sans précédent, sous toutes les latitudes. L’Union européenne a construit un marché continental sans frontières intérieures. L’Europe de l’est, Russie comprise, a reconnu la faillite de l’économie planifiée. L’Amérique latine a tourné le dos aux stratégies de substitution aux importations. La Chine a jeté son énorme masse dans la danse de l’économie de marché, avec un brio stupéfiant. La plupart des pays en développement attendent désormais leur salut économique des exportations.
L’institut Petersen a construit un indice synthétique d’ouverture commerciale. Les résultats peuvent être résumés comme suit. A partir de la fin du XIXème siècle, les échanges ont oscillé entre 10% et 20% du PIB mondial, avant de s’effondrer du fait de la crise de 1929 et de la Seconde guerre mondiale. L’après-guerre (Plan Marshall, GATT, Dillon round, Kennedy Round…) a vu un redressement vers les 20%, puis une progression régulière conduisant à dépasser les 30% dans les années 1970, taux déjà historiquement inédit. A partir de ce seuil, les années 1980, 1990 et 2000 ont vu un quasi-doublement, l’indice atteignant en 2008 la valeur de 60%. Depuis la crise financière, il a oscillé entre 50% et 60%[1]
Bilan coûts-avantage du commerce : la révision à la baisse
L’ouverture commerciale a généré des gains massifs d’efficacité et de pouvoir d’achat mais, justement : certains se demandent si les principaux bénéfices ne sont pas derrière nous, du moins dans les pays développés[2]. Le raisonnement marginaliste a pu, dès lors, être retourné contre le protectionnisme.
L’interpénétration des tissus productifs et la mondialisation des firmes ont atteint un stade jusque-là inenvisageable. Les progrès de la logistique et des nouvelles technologies ont permis un approfondissement de la spécialisation, d’un composant à l’autre, pour des biens qui en comptent souvent des milliers, voire davantage. Comme l’avait montré Suzanne Berger dès 2006, un produit peut franchir la frontière plusieurs fois, le but étant de recevoir des transformations ou des additions de pièces supplémentaires là où les conditions s’y prêtent le mieux, notamment en termes de coût, disponibilité ou qualification de la main d’œuvre [3].
Comme souvent en économie, un phénomène de mode s’est ajouté aux opportunités avérées. Certaines délocalisations ont été motivées par des gains modestes.
Les réticences hexagonales à l’accord de libre-échange UE-Mercosur signé en 2024 sont révélatrices. Dans cet accord, les perspectives d’importations agricoles vers l’Union européenne sont limitées et encadrées. Mais, comme l’a montré Denis Tersen, les gains français à l’exportation permis par cet accord sont trop minces pour que les politiques soient prêts à l’assumer[4]. L’aéronautique, enjeu offensif français majeur, est par exemple déjà exonérée de droits de douanes en vertu d’un accord GATT spécifique [5]. En termes d’ouverture commerciale, il n’y a plus de progrès à attendre dans ce secteur.
Côté inconvénients, les dépendances et pénuries apparues lors de la crise Covid ont servi de révélateur. Gains amenuisés d’un côté, interdépendances aigües de l’autre : la prise en compte des risques vient ternir encore plus le bilan coûts-avantages de l’ouverture commerciale.
A cela s’ajoutent les coûts du transport, qui mobilisent contre le commerce international un réflexe écologique. Le transport est associé à une série d’externalités environnementales négatives, notamment des émissions carbones significatives. Ces dernières sont exorbitantes dans le cas du transport aérien de certaines marchandises (par exemple les fruits et légumes de contre-saison).
2/ Une fragmentation politique venant bousculer les rapports économiques
Le ralliement général à l’économie de marché avait laissé espérer un apaisement en profondeur des rapports internationaux. Les lois de l’ouverture étaient censées faire écho au « doux commerce » de Montesquieu et accoucher d’une forme de convergence politique.
Cette prévision a été peu à peu démentie par les évènements. La mondialisation a été suivie, au contraire, d’une relance de la fragmentation politique du monde.
La résilience de l’autoritarisme au sein des nouveaux capitalismes
Lors de la répression des émeutes de Tienanmen, en 1989, le pouvoir chinois incarné par Deng Xiaoping avait fait miroiter aux contestataires et à l’Occident, une perspective démocratique. A court terme, la discipline politique sous l’autorité du parti communiste était censée s’imposer pour assurer le développement. Mais, ensuite, celui-ci rendrait la démocratie inéluctable. Faux présage. Cette « loi de l’histoire » ne s’est pas concrétisée, bien au contraire.
Le parti communiste chinois est parvenu à conserver sa mainmise sur le pays. Il est parvenu à conjuguer, d’un côté, la répression et la surveillance et, de l’autre, une gouvernance économique sophistiquée qui a permis une réussite industrielle et technologique brillante.
Le cas de la Russie est distinct : le monopole du parti unique y a été démantelé. Il l’a été à l’initiative même des dirigeants communistes conscients de l’échec de leur système, Gorbatchev en tête. L’Occident, qui ne s’y attendait guère, a alors encouragé une transition à grandes enjambées vers l’économie de marché. Il était convaincu que celle-ci consoliderait les premières avancées de la démocratie.
Hélas, l’absence de tradition démocratique, le jeu des maffias et les rentes associées aux activités extractives ont accouché d’une toute autre équation. Une forme d’autoritarisme s’est reconstituée, avec une continuité assurée par les services secrets, d’abord discrètement, puis de façon voyante.
Toutefois, l’économie russe est une économie de rente (pétrole, gaz et, de plus en plus céréales). Elle joue sur son pouvoir de fournisseur. Mais celui-ci n’affecte l’occident que dans la mesure où il dépend de ses matières premières.
Indépendamment de tout jugement politique, la persistance de l’autoritarisme emporte des conséquences économiques spécifiques dans les rapports avec la Chine, compétiteur redoutable : elle permet de biaiser les lois de la concurrence et de soumettre les firmes à des objectifs fixés par le politique.
Ces phénomènes existent, certes, en économie de marché. Mais, ici, ils atteignent à une dimension bien supérieure : coercition physique exercée par le pouvoir sur les détenteurs de capitaux, rôle opaque des entreprises d’Etat et, bien sûr, manque d’indépendance de la justice. Tout cela assure aux autorités politiques une emprise sur l’économie qui leur est inaccessible dans les véritables démocraties.
Paradoxalement, cette emprise n’est pas incompatible avec la décentralisation des décisions économique, clé d’efficacité du marché. Disposant de forces de rappel incomparables, la direction politique chinoise peut jouer la décentralisation sans craintes. Elle est passée maître dans cette façon sophistiquée de biaiser la concurrence.
Pour l’Occident, la déconvenue est douloureuse. De là son retard à accepter la réalité.
Les préjudices résultant de pratiques déloyaleset de subventions d’Etat peuvent certes être mesurés. Des rétorsions sont envisageables et, d’ailleurs, déjà pratiquées. Néanmoins, les efforts de l’OMC pour élaborer une régulation plus performante et des procédures plus efficaces ont buté sur les désaccords entre « parties-prenantes » (terme désignant, dans le langage de l’OMC, les Etats membres). La voie est ainsi ouverte à d’autres moyens, plus unilatéraux et… réservés aux plus forts.
La rivalité systémique Occident-Chine
Comme l’a théorisé Josep Borrell, Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique extérieure de 2019 à 2024, la Chine est à la fois « un partenaire, un concurrent et un rival systémique ». De Berlin à Seattle ou Tokyo, les Occidentaux reprennent souvent cette antienne. Mais ils ne placent pas l’accent sur le même terme.
Pour l’Allemagne, c’est le partenariat qui est essentiel. Ses grands groupes ont investi en Chine après la crise financière de 2008 et ils y réalisent une part majeure de leurs profits, notamment dans l’automobile.
A Washington, c’est la rivalité systémique qui obsède
Le spectre d’une avance chinoise dans le domaine de l’intelligence artificielle, des biotechnologies et des semi-conducteurs est bien plus préoccupant, en fait, que ne le fut naguère le « missile gap », après le lancement du premier satellite soviétique. A la différence de l’URSS, la Chine est économiquement compétitive. Elle dispose de moyens financiers à la mesure de son énorme population.
En termes de civilisation, son altérité est bien plus accusée que celle de la Russie, laquelle a toujours tenu à se rattacher à l’espace culturel européen (une caractéristique qui ne fut peut-être pas étrangère à l’aveu final, par le parti communiste soviétique, de l’échec de son idéologie).
Hier, la Chine et la Russie emboîtaient le pas à l’Occident sur l’économie de marché. Aujourd’hui, c’est l’Occident qui se préoccupe d’aligner davantage les priorités de ses entreprises sur les intérêts nationaux.
La fragmentation du monde et les tensions géopolitiques
L’invasion de l’Ukraine a produit deux effets géopolitiques successifs.
Le premier est bien évidemment le retour de la guerre de haute intensité en Europe. Une pression inédite pèse sur l’Union européenne. Après avoir cultivé l’idée de rapports internationaux fondés sur les règles, elle se trouve aux prises avec une réalité géopolitique rugueuse.
L’action de la Commission européenne s’efforce d’intégrer cette réalité mais le droit européen ne va pas dans ce sens : sa philosophie est d’élargir la place des règles…
A partir de 2022, l’Union européenne a procédé à des sanctions économiques sévères contre la Russie et dû pourvoir dans l’urgence à ses besoins en gaz. La cloison séparant les échanges de la politique est fissurée, sans que l’on connaisse encore avec certitude l’impact des sanctions. Celles-ci sont pénalisantes pour l’économie russe, privée de composants essentiels et de biens appréciés des consommateurs. Mais elles n’ont pas empêché l’effort de guerre. Moscou s’est tourné vers d’autres fournisseurs, au détriment des entreprises occidentales.
S’il en est ainsi, c’est que de nombreux pays ont refusé de sanctionner la Russie, malgré son recours indéfendable à la force.
Là intervient la deuxième conséquence géopolitique du conflit ukrainien : ses effets sur le reste du monde. Face à l’Occident, deux groupes de pays apparaissent désormais.
Le premier groupe est formé par l’alliance objective de la Russie et de la Chine, sorte de pôle oriental reconstitué, cherchant à changer les règles de l’ordre international.
Le second groupe correspond à ce que l’on appelle le Sud global. Il est plus disparate mais fort étendu. Il rappelle à certains égards les non-alignés de l’époque des trente glorieuses occidentales. Mais il est mû par des appétits moins idéologiques et… mieux aiguisés.
Le « Sud global » peut tirer grand avantage de la rivalité entre les deux autres pôles, tant économiquement que politiquement. Il joue pour cela le pragmatisme, et non les principes, qu’il estime lui aussi biaisés en faveur de l’occident.
C’est donc à une fragilisation générale des règles que l’on assiste. Cette fragilisation aide le protectionnisme à se frayer une voie : c’est pour lui faire barrage, précisément, que les règles avaient été conçues au lendemain de la Seconde guerre mondiale.
Au cercle vertueux de l’approfondissement des règles a succédé l’enchaînement pernicieux de leur affaiblissement. Tel est le contexte mondial.
Surce fond de tableau international, le protectionnisme américain est aussi un phénomène national nourri par des forces politique intérieures et conditionnant les politiques publiques.
La rhétorique protectionniste, de la théorie à la pratique
1/ Mondialisation et trouble identitaire
Au-delà même du commerce, la mondialisation a revêtu de multiples aspects : finance, technologies, réseaux en tous genres. Ils lui ont donné le visage d’une intégration en profondeur, défiant le pouvoir des Etats au point d’insécuriser les populations.
Le trouble causé par la mondialisation n’est pas étranger à la repondération qui s’opère dans l’esprit des citoyens entre préoccupations économiques et aspirations identitaires.
Les mécanismes du retour en force de ces aspirations ont été magistralement analysés dans un livre de Francis Fukuyama, hélas non traduit en français, Identity[6]. En néo-hégélien, il met en garde contre la surestimation des motivations économiques, un travers dans lequel tombent, à la fois, les héritiers de Marx et ceux de Smith, Ricardo et Friedman. Selon lui, le besoin le plus important de l’être humain est la dignité, qui suppose de voir son identité respectée et son statut reconnu.
Fukuyama développe un argument très convaincant : même la consommation et l’accès aux biens, symboles par excellence du matérialisme de nos sociétés, peuvent être mus par le désir de renvoyer une image de soi. Ce mobile a souvent un pouvoir explicatif supérieur à celui des besoins directement matériels. Les Yachts des milliardaires en sont un exemple. Mais le même mobile se retrouve dans la classe moyenne, avec le « Keep up with the Jones » des manuels d’économie et le poids du regard des autres dans certains achats de biens.
Avec la réduction de la pauvreté absolue et les gains du libre-échange, les considérations matérielles voient leur importance relative diminuée.
Les aspirations identitaires gagnent, quant à elles, en acuité : identification au territoire, besoin de sécurité culturelle, aspiration à voir les autorités en situation d’agir.
La littérature s’est emparée de ces aspirations.
Hillbilly Elegy, le livre de James David Vance, a été un bestseller en 2016, huit ans avant que son auteur ne soit propulsé à la vice-présidence des Etats-Unis. Traduit (quant à lui) en français dès 2018[7], il relate l’enfance de l’auteur dans les Appalaches. Cette vaste région à cheval sur plusieurs Etats a été touchée par la désindustrialisation. Ses personnages sont frappés par la pauvreté mais également par une perte identitaire avec la disparition d’industries qui faisaient la fierté de leur territoire.
Tel est le vécu d’une partie des habitants du « mur bleu », ces régions traditionnellement démocrates qui ont basculé en faveur de Trump en 2016 et, de nouveau, contribué à sa victoire en 2024.
En Angleterre, les livres de Jonathan Coe racontent quant à eux des destins aux prises avec les évolutions sociétales. Tel est, notamment le cas de The Middle of England, paru en 2018 mais dont l’action débute en 2010, six ans avant le référendum ayant conduit au Brexit[8].
A sa manière, l’Institut Petersen a pris acte de l’évolution des esprits : le slogan It’s the economy stupid n’a plus la même valeur[9]. Alors, faut-il désormais dire Identity stupid ?
En tout cas, les appels à la souveraineté économique résonnent y compris au sein de l’Union européenne, qui tente d’amender son logiciel.
2/ Les leçons du premier mandat Trump (janvier 2017-janvier 2021)
Bien qu’erratique, ou peut-être pour cette raison, Trump One a servi de galop d’essai.
Les annonces et mesures protectionnistes l’ont rythmé. Trump a rompu avec une forme de résignation américaine devant la menace de domination des marchés par la Chine. Beaucoup, à Washington, le créditent de sa position sur ce point.
Les mesures commerciales ne sont pas anodines envers un pays dont la croissance demeure extravertie, donc vulnérable. Elles ont fait l’objet de vagues successives. La Chine y a réagi par des mesures de rétorsion visant – entre autres - l’agriculture américaine. Des aides fédérales sont venues dédommager les exploitations les plus affectées.
Toutefois, l’ampleur effective du protectionnisme est demeurée, au cours du premier mandat, plus restreinte que les annonces ne le laissaient croire. Ces tarifs étaient souvent très sélectifs ce dont la communication se gardait de faire état. Les droits de douanes moyens ont cru par rapport à ceux déjà en place sous Obama. Ils ont franchi le seuil de 10% vis-à-vis de la Chine mais ils sont demeurés globalement modérés sur les biens de consommation[10]. De là, le faible impact inflationniste.
Néanmoins des droits sectoriels plus dissuasifs ont été instaurés dans deux secteurs de biens intermédiaires, l’acier et l’aluminium, productions emblématiques des « cathédrales industrielles » marquant certains paysages. Les droits « métalliques » ont permis le maintien ou la mise en service d’installations, avec des emplois directs à la clé.
Leur nombre serait d’une dizaine de milliers selon les défenseurs de ces mesures. Néanmoins, le coût unitaire par emploi serait très élevé, pouvant atteindre 900 000 dollars annuels par emploi sauvé ou rapatrié dans la production d’acier[11]. C’est l’industrie aval qui les a supportés. Comme elle est plus intensive en main d’œuvre, le nombre d’emplois détruits est supérieur à celui des emplois sauvés en amont. Mais le coût monétaire s’en est trouvé dilué. Le consommateur final ne les a guère ressentis, l’impact macroéconomique étant limité par le ciblage sectoriel. Economiquement contestables, ces mesures ont un impact symbolique indéniable.
Dès lors qu’il est supportable pour le consommateur, le tournant protectionniste envers la Chine est peu réversible : cela mettrait en danger les productions locales ayant prospéré sous cet abri.
D’autres prises de positions du président Trump sont apparues fragiles, voire fallacieuses. Il en va ainsi du projecteur braqué sur les soldes commerciaux bilatéraux. Le solde bilatéral avec un pays donné n’est qu’un indicateur partiel[12].
De même, Donald Trump a déclaré injuste, voire déloyale (unfair), l’inégalité des droits de douanes sur l’automobile : 5% aux Etats-Unis, 10% en Europe. Il y voit le facteur explicatif du succès des automobiles allemandes aux Etats-Unis.
C’est gommer deux éléments. D’abord, les droits de douanes résultent des offres globales faites par chaque pays dans le cadre des négociations à l’OMC, offres dans lesquelles chacun choisit librement ses priorités sectorielles. Par construction, il n’y a pas d’égalité systématique des droits de douanes entre les parties-prenantes à l’OMC dans un secteur donné. Si les Etats-Unis ont offert 5% sur l’automobile, c’est pour obtenir de leurs partenaires de moindres droits sur d’autres marchés, qui les intéressaient davantage. De plus, ils ont accepté les droits de douanes européens car ils visaient des pays tiers (Asie) et affectaient peu l’industrie automobile américaine. Même avec des droits zéro, celle-ci aurait peiné à vendre ses voitures en Europe[13].
Autre exemple de rhétorique trompeuse : la promesse de faire financer le budget des Etats-Unis par les pays fournisseurs, ceci en lieu et place des contribuables américains. Les droits de douanes sont versés par les importateurs qui, sauf exception, les répercutent sur les consommateurs. Ces derniers sont donc les contribuables en dernier ressort[14].
La pression exercée par les menaces et mesures américaines n’en est pas moins réelle en raison des dégâts susceptibles d’être causés à des économies plus petites.
En 2019, Donald Trump avait brandi la menace de droits de douanes punitifs pour exiger du Mexique un contrôle plus strict des migrations. Le président Andres Manuel Lopez Obrador avait reçu le message et envoyé l’armée aux frontières pour freiner les passages de clandestins.
Cette expérience est fondatrice. En 2024, elle amènera Trump à soutenir, dans une apparente antiphrase, que « les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner ».
Le lien entre protectionnisme et migrations illustre l’éclipse du raisonnement habituel.
En économie, mettre l’immigration et les importations dans le même sac peut faire sourire. Pour la théorie la plus éprouvée, ce sont au contraires deux manières alternatives de s’adapter aux avantages comparatifs. Soit l’on fait venir la main d’œuvre dans les pays industriels pour pouvoir continuer à y produire des biens à forte intensité en travail. C’est alors ce facteur qui se déplace. Soit le facteur travail est immobile et ce sont alors les marchandises qui s’échangent. Autrement dit, l’immigration permet de produire plus et d’importer moins.
Mais, du point de vue politique, l’enjeu est un rapport de force en vue du contrôle de l’immigration clandestine. Les échanges ne sont plus qu’une masse de manœuvre.
3/ Les leçons de la Présidence Biden (janvier 2021-janvier 2025)
Joe Biden est sans doute le président arrivé à la Maison Blanche, avec la plus forte expérience internationale. De plus, son élection a été précédée d’une analyse méthodique de la crise de la démocratie américaine. Ce sujet a fait l’objet d’un livre de Renaud Lassus dont il a été rendu compte dans Commentaire[15]. L’impact des échanges sur la large classe moyenne américaine, au cœur de cette crise, a été étudié en détail par le Rapport de la Fondation Carnegie précité.
Joe Biden a démantelé certaines mesures protectionnistes introduites par Donald Trump à l’encontre de pays occidentaux mais il en a maintenu d’autres en place, notamment visant la Chine. Leur démantèlement n’aurait pas été compris par l’électorat de cols bleus qu’il avait fait basculer en sa faveur en 2020 et espérait durablement regagner[16].
Il reste que sa présidence s’est caractérisée par la recherche d’alternatives « rationnelles » au protectionnisme.
Le diagnostic était celui de la rivalité systémique avec la Chine. Les démocrates n’étaient pas non plus en désaccord avec les républicains concernant certains impacts négatifs du commerce sur les populations et les territoires. Mais ils introduisaient un bémol dans les leçons à en tirer : l’impact du protectionnisme sur le pouvoir d’achat.
Le leadership mondial des Etats-Unis étant défié, ce sujet a été placé au cœur de leur politique extérieure. Le Conseiller à la Sécurité nationale du Président Biden, Jake Sullivan a été, pour la première fois, également en charge de la technologie. Cette répartition des responsabilités contenait un message : la rivalité avec la Chine légitime le rôle stratégique de l’Etat en matière économique. Pour la patrie de la libre entreprise, c’est une inflexion notable.
Ce rôle peut s’exprimer par des programmes à long terme, les mieux à même de remédier aux déficiences structurelles, que ce soit sur le plan de la compétitivité ou des conditions de vie.
Le Président Biden est parvenu à faire passer au Congrès une séries de grandes lois, notamment dans les domaines des infrastructures et de la politique industrielle. Ce furent, en novembre 2021, Infrastructures, Investment and Jobs Act et, en août 2022, Science and Chips Act. Il est à noter que ces deux lois majeures, votées avant les midterms de novembre 2022, ont été adoptée de manière bipartisane (majorité de l’ordre des deux tiers des sénateurs), un fait à souligner en des temps d’extrême polarisation de la vie politique américaine[17].
Les infrastructures sont une priorité peu discutée des politiques publiques, partout dans le monde. Ils se trouve qu’elles sont souvent insuffisantes ou dégradées aux Etats-Unis (routes, ponts, conduits d’eau, réseaux de fibres et d’électricité).
« Trump One » avait lui-même indiqué vouloir leur consacrer davantage de financements, sans y parvenir. C’est la longue habitude du Congrès de Joe Biden et, une fois président, son engagement intense dans les négociations avec les parlementaires qui a fait la différence.
Le Science and Chips Act procède d’une politique industrielle, notion nouvelle aux Etats-Unis.
D’aucuns voient en elle une forme de protectionnisme déguisé. Assurément, l’octroi de moyens financiers publics à la production nationale traduit l’intention d’agir sur les termes de la concurrence. Mais certaines formes de politique industrielle sont désormais considérées, y compris à l’OCDE, comme utiles à la création de richesse. En cela, elles ne peuvent pas être assimilées à du protectionnisme. Il en va ainsi des mesures transversales en faveur de la science fondamentale et de la recherche, ou encore du financement public d’investissements de long terme susceptibles d’être pénalisés par la myopie du marché.
Les grands programmes susmentionnés sont peu contestés et pourraient éventuellement continuer à être mise en œuvre sous l’administration Trump Two.
Dans une perspective de rivalité avec la Chine et de compétition internationale, des leviers autres que les droits de douanes peuvent servir à concentrer les connaissances technologiques et les investissements aux Etats-Unis. C’est alors une forme de politique industrielle plus proche du protectionnisme. Sous le président Biden, elles ont inclus des financements et incitations « positives » sous de multiples formes. Ils figurent notamment dans l’Inflation Reduction Act (IRA) voté par le Congrès en 2021 et qui a beaucoup alarmé les Européens en raison de l’attraction en faveur des investissements aux Etats-Unis, attraction confirmée depuis.
D’autre leviers prennent la forme de contrôles, pénalisations et embargos destinés à empêcher les transferts de technologies vers des pays rivaux. C’est la recherche du découplage. A cet égard, l’administration Biden avait affiché la volonté d’une défense vigoureuse mais ciblée (A small yard with a high fence).
A la différence des mesures horizontales, le concept d’activités « stratégiques » est contesté. Il procède d’une approche sectorielle dont les économistes se méfient car ils y voient un biais souvent mal délibéré dans l’affectation des ressources. S’agit-il d’activités liées à la défense ? Ce n’est pas une définition économique. S’agit-il d’activités « économiquement » stratégiques (dites sensitive aux Etats-Unis) ? Le concept est alors flou. Néanmoins, une forme de découplage est intervenue dans certains secteurs, notamment ceux liés aux semi-conducteurs et à l’intelligence artificielle. Elle concerne surtout les rapports entre les Etats-Unis et la Chine et pourrait aboutir à l’affirmation d’écosystèmes séparés dans les secteurs les plus sensibles.
En termes pratiques, les dommages associés à la perte de leadership technologique et aux atteintes à la propriété intellectuelle sont difficiles à quantifier. Ceci nous éloigne de toute objectivation et, notamment, la proportionnalité des rétorsions, qui constitue un élément du commerce par les règles promues par l’OMC. En pratique, le découplage est resté limité et concerne surtout la chine et les Etats-Unis, comme l’ont montré Thomas Gomart et Sébastien Jean en 2023[18].
Les plus tangibles des programmes mis en place par Joe Biden n’en restaient pas moins les grandes lois « Infrastructures » et « Science and Chips ». « Vertueusement », elles visaient le long terme. Ce faisant elles eurent un faible impact immédiat sur les électeurs. Pour d’autres raisons (inflation), ils percevaient négativement le bilan économique de Biden. Elles ne suffirent donc pas à inverser leur jugement et à empêcher la victoire républicaine de 2024.
Nouveaux jeux de forces en perspective
Lors de son premier passage à la Maison blanche, Donald Trump avait mis du temps à concrétiser ses menaces protectionnistes. En 2025, il est passé d’emblée à l’action, allant jusqu’à installer, par des annonces quotidiennes, un feuilleton.
Il a menacé la Colombie de droits de douanes punitifs pour imposer l’atterrissage d’avions de migrants à Bogota. Il a décrété des droits de douanes contre la Chine, le Mexique et la Canada en exigeant qu’ils contrôlent les passages de clandestins à leurs frontières et empêchent les livraisons de Fentanyl, substance anti-douleur provocant des ravages aux Etats-Unis.
Un nouveau paysage se met en place, dont on peut commencer à discerner les contours.
1/ L’éventualité de succès domestiques pour l’administration républicaine
Postulat du président : tout ce qui affecte les Etats-Unis, ou presque, peut faire objet de marchandages.
Si cette approche débouche sur des gains politiques, économiques ou sociaux sans coûts exorbitants, le président peut voir sa popularité confortée. Dans le meilleur des cas, on assisterait à un apaisement de l’opinion américaine vis-à-vis de la mondialisation.
Ce serait alors une réponse involontaire au problème de la déconnexion entre échanges et outils de régulation étatiques, naguère soulevé par Karl Polanyi [19]. Celui-ci avait, à propos de la première mondialisation (période de l’étalon-or), pointé l’absence de possibilité d’amortissement ou d’ajustement. Une sorte de « reconnexion », lisible au moins par l’opinion américaine, s’opérerait ainsi.
Néanmoins, les mauvaises surprises guettent : mesures mal calibrées entraînant inflation ou récession, tensions politiques rejaillissant sur les Etats-Unis, affaiblissement des alliances, durcissement des partenaires commerciaux.
Tout dépendra, à cet égard, du réalisme des objectifs et de la capacité d’évaluation de l’administration républicaine. Il est légitime de détester le langage brutal de Donald Trump et nombre de ses électeurs en sont parfois eux-mêmes hérissés. Il s’avère que cette brutalité s’accompagne de flexibilité dans l’action. On l’a vu en février 2025 : après un début de chute à Wall Street, certaines mesures contre le Canada et le Mexique ont été promptement retirées. L’effet de démonstration prime souvent sur l’effectivité.
2/ Un impact ambivalent sur la Chine
Il est peu probable que les mesures américaines puissent aller jusqu’à déstabiliser l’empire du milieu. Les intérêts économiques des deux grands sont trop imbriqués, les profits des firmes US trop largement dépendants de leur activité en Chine et les capitaux chinois trop cruciaux pour le financement du trésor américain.
Si elle n’est pas déstabilisée, la Chine peut trouver son compte au découplage, qui l’aidera à développer son marché intérieur et à réactiver le principe maoïste « compter sur ses propres forces. L’élection américaine de 2024 a été saluée par certains milieux nationalistes chinois voyant d’un bon œil l’exaltation des intérêts nationaux.
La capacité américaine à freiner les percées technologiques de la Chine reste à mesurer : ce pays est déjà fort avancé et l’effet des embargos est controversé.
3/ Un nouvel usage de la force à l’encontre du Sud global
Le protectionnisme à la Trump est une arme profondément asymétrique par les dommages qu’il peut causer à des économies en développement : leur dépendance envers le marché US est bien supérieure à la réciproque. De plus, pour ces pays, les bénéfices du commerce restaient en grade partie devant eux. Il ne faut pas sous-estimer la rupture que cette arme asymétrique représente dans les rapports avec le monde en développement.
La doctrine mise en œuvre depuis les Accords GATT (1947) et la création de l’OCDE (1961) visait le contraire : une discrimination positive en faveur de ce dernier, par exemple avec la notion de tarifs préférentiels ou celle d’engagements différenciés en fonction du niveau de développement (notion de traitement spécial et différencié, GATT, 1979[20]).
Ces pays pourraient regretter de s’être engagés avec confiance dans les échanges économiques avec un pays qui tourne le dos à cette vision.
Les Etats-Unis, de leur côté, peuvent voir dans cette affirmation des forts une réponse au défi posé par le « Sud Global ». Ce concept est flou mais il reflète une possibilité pour les pays concernés : démultiplier, grâce à la diversité de leurs partenaires, leurs marges de manœuvres, ceci pour mieux négocier avec l’Occident, comme l’a récemment souligné Zaki Laïdi dans une interview au Monde[21].
Au-delà de l’impact immédiat, les mesures prises visent à faire évoluer la stratégie d’investissement des firmes. C’est elle qui façonne les chaînes de valeur et l’agencement du « système » productif mondial. Commet les firmes réagiront-elles ?
A court terme, elles agiront comme une corde de rappel, en mettant en garde contre les ruptures de chaînes de valeurs, dévastatrices pour l’emploi mais aussi pour la sation de leurs capitaux.
A plus long terme, elles pourraient opter pour un raccourcissement des chaînes de valeur, moyen pour elles de diminuer la « prise au vent » offerte aux politiques protectionnistes. En termes d’approvisionnements industriels, cela revient à privilégier la part locale et à jouer davantage la carte des écosystèmes productifs nationaux. Cette perspective serait favorable aux pays de consommation des produits et ne serait pas toujours défavorable aux pays en développement, désireux de voir leur appareil productif répondre davantage aux besoins de leurs marchés intérieurs. Les stratégies « mercantilistes » d’accumulation d’excédents commerciaux seraient, en revanche, rendues plus difficiles.
CONCLUSION
L’aventure du nouveau protectionnisme ne fait que commencer. Elle promet d’être cahoteuse. Parviendra-t-elle, au bout du compte, à limiter les dégâts et à rasséréner les populations à bon compte ? Aux Etats-Unis, cela est, à la rigueur, imaginable. Ailleurs, c’est plus qu’incertain car leur exemple n’est pas exportable. Mis à part la Chine, leurs partenaires sont, soit trop faibles, soit trop contraints par les règles.
D’un point de vue collectif, le bilan ne peut être que négatif. Le protectionnisme américain ne va pas dans le sens d’une mondialisation maîtrisée, qui demande une approche non conflictuelle des relations économiques. Son opposition aux tentatives pourtant raisonnables d’impositions minimale des firmes multinationales dans le cadre de l’OCDE en est un exemple. La volonté de mettre fin à l’aide au développement est un autre exemple : elle scie l’un des canaux reliant pays en développement et pays riches.
Pour la coopération internationale, le protectionnisme reste un poison.
[1] Cet indice consiste à rapporter la somme des importations et exportations au PIB mondial, ceci à partir des données de la Banque mondiale). Les résultats ont fait l’objet d’une infographie réalisée par Le Monde en janvier 2025 : https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/01/17/avec-le-retour-de-donald-trump-le-monde-tourne-la-page-de-decennies-de-libre-echange_6502522_3234.html.
[2] On trouvera une évaluation méthodique de ce point dans le Rapport Making Foreign Policy work better for the Middle Class, Fondation Carnegie pour la Paix, 2017. Grâce à l’ouverture commerciale, les dépenses d’habillement des ménages américains sont passés de 5,9% de leur budget en 1980 à 2,9% en 2019. Cette chute amenuise les perspectives de gains de pouvoir d’achat dans ce secteur.
[3] Suzanne Berger, Made in Monde, Les nouvelles frontières de l'économie mondiale, Le Seuil, Paris, 2006.
[4] https://www.lagrandeconversation.com/monde/ue-mercosur-pour-la-france-il-ny-a-pas-de-commerce-heureux/
[5] Accord plurilatéral sur le commerce des aéronefs civils, 1980.
[6] Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Farrar Straus & Giroux, New-York, 2018.
[7] J.D. Vance, Hillbilly Elégie, traduit en français par Vincent Raynaud, Le Livre de poche, Paris, 2018
[8] Traduit en français par Josée Kamoun sous le titre Le Cœur de l’Angleterre (Gallimard, 2019).
[9] https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/its-economy-stupid-doesnt-ring-so-true-era-hyperpartisanship
[10] Voir https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2024-mai/chine-la-hausse-des-droits-de-douane-americains-est-d-abord-un-enjeu-politique
[11] https://www.vox.com/politics/399187/why-trumps-proposed-metal-tariffs-are-such-a-strange-idea
[12] La balance commerciale bilatérale peut être affectée par des biais allant jusqu’à fausser complètement son interprétation, notamment pour les biens dont l’offre mondiale est contrainte. Par exemple, si la France décidait d’importer tout son pétrole d’un seul pays, cela creuserait démesurément le déficit avec ce pays mais cela affecterait peu le solde commercial français : le pétrole ainsi importé n’aurait plus besoin de l’être à partir des autres pays. Inversement, si un réservait ses importations de blé à la France, cela ne changerait guère sa propre balance globale, ni celle de la France, qui en vendrait moins à d’autres pays).
[13] Les voitures électriques Tesla présentes sur nos routes sont fabriquées à Berlin ou Shanghai.
[14] Il existe des nuances. Parfois, les fabricants étrangers, importateurs ou distributeurs choisissent de pas répercuter la totalité des hausses de droits sur les consommateurs, en rognant leurs profits. En ce cas, les acheteurs finaux ne supportent les hausses que partiellement. Parfois, les droits de douanes ont pour effet de faire baisser sur le marché mondial le demande du produit importé, au point où son prix chute. Le pays exportateur voit alors ses termes de l’échange se dégrader, ce qui l’appauvrit, tandis que le pays importateur se procure le bien à un moindre coût. Cet effet sur les termes de l’échange a été mis en évidence par Paul Samuelson, d’où son nom « l’effet Samuelson ».
[15] Le Renouveau de la démocratie en Amérique, Renaud Lassus, préface de Pascal Lamy, Editions Odile Jacob, Paris 2019. Recension dans le numéro N°184 de Commentaire.
[16] A la fin de son mandat, Biden a instauré des droits sur les véhicules électriques. Ces biens n’étant pas encore réellement importés par les Etats-Unis, leur taxation n’est guère ressentie par les consommateurs. Elle peut s’apparenter à la notion d’industries naissantes, cas de protectionnisme « rationnel » admis depuis longtemps (théorie des industries naissantes, Friedrich List).
[17] L’auteur a proposé un inventaire raisonné des programmes de la présidence Biden dans un Policy report publié en 2024 : https://www.policycenter.ma/index.php/publications/assessing-bidens-presidency-method
[18] Découplage impossible, coopération improbable. Les interdépendances économiques à l’épreuve des rivalités de puissance, Etudes de l’IFRI, novembre 2023.
[19] Karl Polanyi, The Great Transformation, 1944. Version française : La Grande Transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, Collection NRF, Paris, 1983.
[20] Le Traitement Spécial et différencié est devenu une règle du GATT en 1979 avec la clause dite d'habilitation. Elle prévoit un traitement préférentiel pour les pays en développement, sans exigence de réciprocité, et tenant compte de leurs besoins en termes de développement.
[21] « Trump croit, comme Poutine, que la vocation des forts est de dévorer les faibles », Entretien avec Zaki Laïdi, Le Monde, 11 janvier 2025