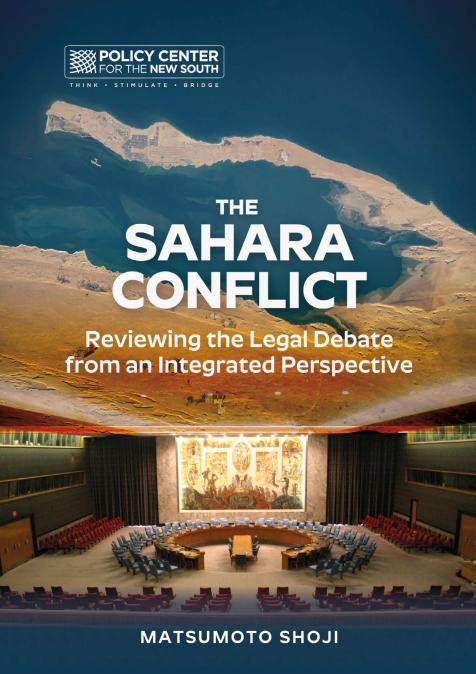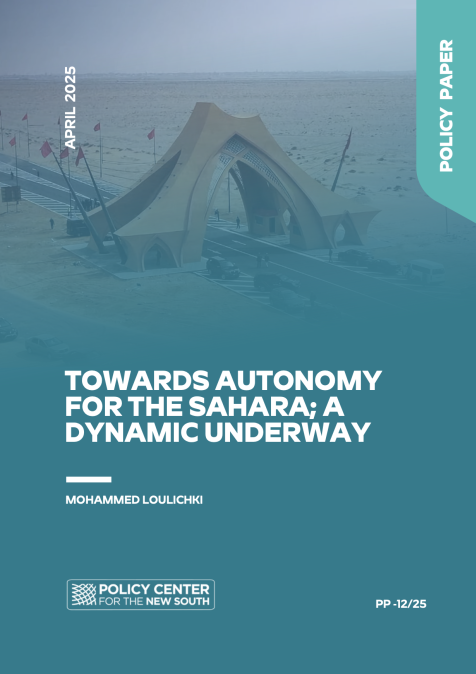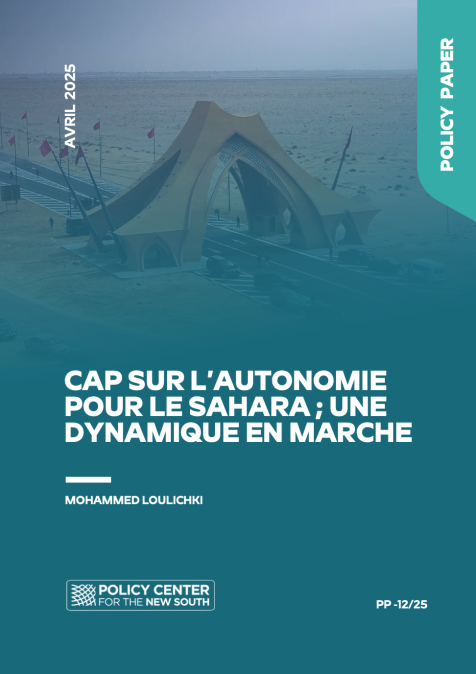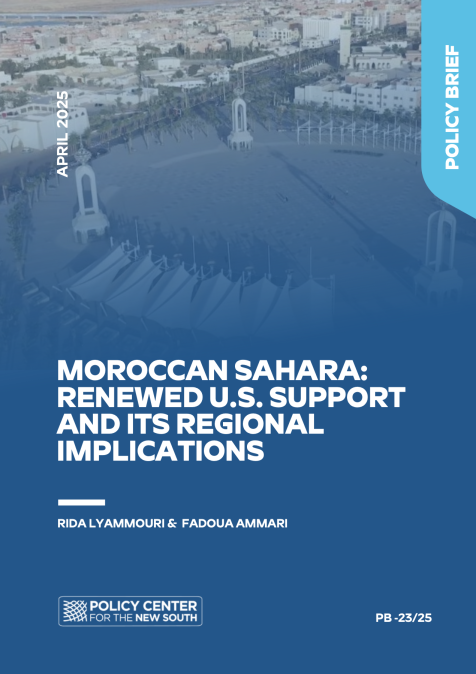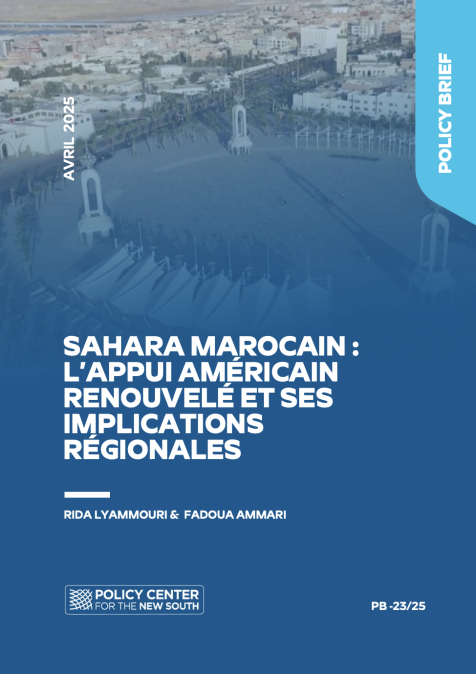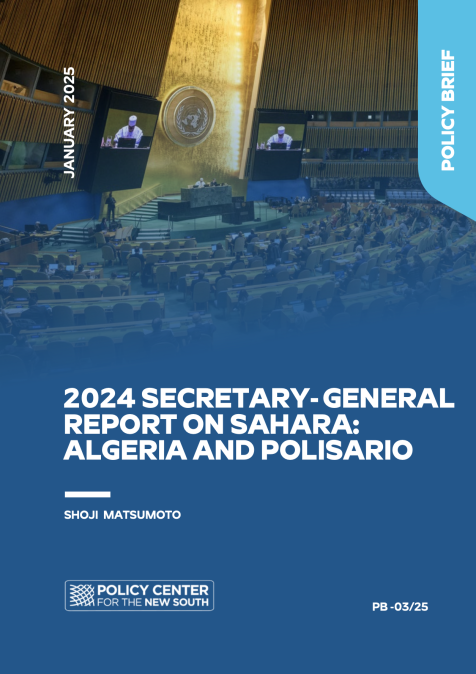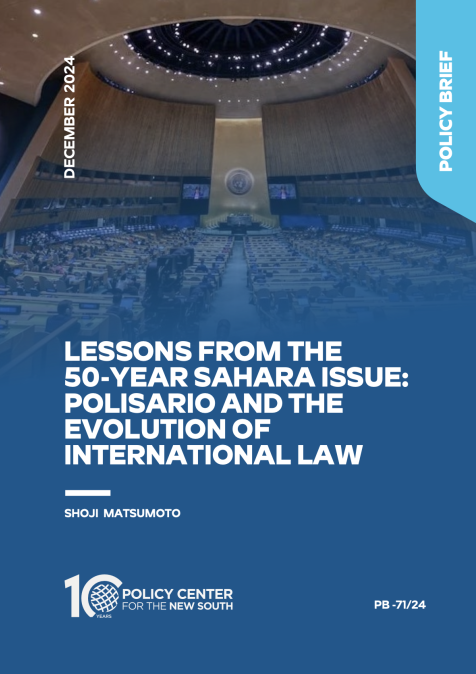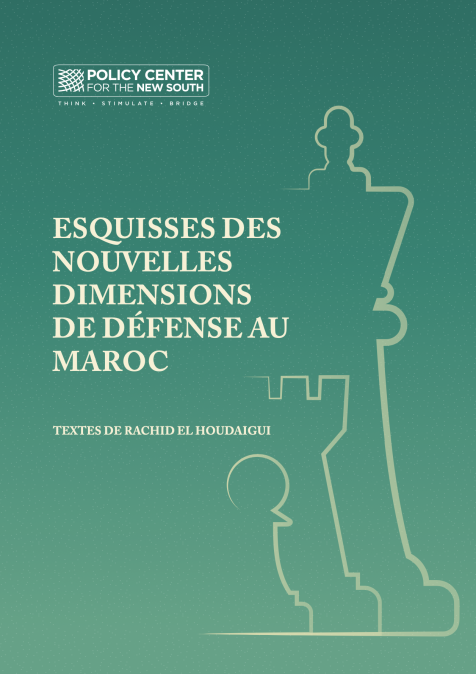Publications /
Opinion
L’ouvrage de Matsumoto Shoji, professeur spécialisé en droit africain comparé et en droit international, est une étude approfondie sur la question du Sahara et ses enjeux juridiques, politiques et diplomatiques. S’appuyant sur une analyse rigoureuse des normes du droit international, des accords passés et des dynamiques régionales, l’auteur met en lumière l’importance de la souveraineté marocaine dans un conflit marqué par des interprétations divergentes de concepts tels que l’autodétermination, l’intégrité territoriale et la représentativité.
Articulé autour de douze chapitres, l’ouvrage propose des analyses juridiques complexes, explorant des thèmes fondamentaux, notamment le jus cogens, le rôle de la Cour internationale de justice (CIJ), l’accord de Madrid et l’Initiative marocaine d’autonomie. Par ailleurs, l’auteur y examine les dynamiques géopolitiques qui ont influencé ce conflit, en les replaçant dans un cadre à la fois historique et contemporain. Cette lecture a pour objectif de mettre en lumière les problématiques traitées dans l’ouvrage, ainsi que les arguments sur lesquels le professeur Matsumoto fonde son analyse, décrite comme une perspective intégrée et multidimensionnelle.
1- Le cadre juridique du conflit autour du Sahara
a. Le jus cogens et le droit à l’autodétermination
Dès les premiers chapitres, Pr. Matsumoto explore le concept de jus cogens, une norme fondamentale du droit international, dont les normes, reconnues comme impératives, interdisent toute dérogation, même par accord mutuel entre les États. Parmi ces normes figurent l’interdiction de la discrimination raciale et le droit à l’autodétermination. L’auteur considère que toute solution au conflit du Sahara doit être conforme à ces principes. Ceci non sans mettre en évidence une contradiction importante : bien que le droit à l’autodétermination soit souvent évoqué dans ce conflit, il n’est pas considéré comme une norme indérogeable dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
Cette observation mène à une réflexion plus large sur les limites de l’application du jus cogens dans les conflits régionaux. S. Matsumoto explique que si le droit à l’autodétermination est invoqué de manière discriminatoire, il peut entrer en conflit avec d’autres normes impératives, comme l’interdiction de la discrimination raciale. Par exemple, un référendum réservé exclusivement à une ethnie / groupe social, tel que proposé par le polisario, violerait les principes fondamentaux du droit international en favorisant une discrimination basée sur l’origine et l’appartenance.
Cette analyse est enrichie par une étude des conséquences de la reconnaissance internationale des normes de jus cogens sur les décisions des Organisations multilatérales. L’auteur cite, à titre d’exemple, des situations similaires dans d’autres régions du monde, comme le Kosovo ou la Crimée, pour établir un parallèle avec la situation du « Sahara occidental ».
b. Les décisions de la Cour internationale de Justice et leurs limites
Le rôle de la CIJ dans le conflit du Sahara est central. Pr. Matsumoto consacre une analyse détaillée à l’Avis consultatif de 1975, dans lequel la Cour a répondu à deux questions principales : le Sahara était-il un territoire terra nullius avant la colonisation espagnole ? Et quels étaient les liens juridiques entre ce territoire, le Maroc et la Mauritanie ?
L’auteur critique la manière dont la CIJ a élargi son mandat en incluant des considérations sur la souveraineté territoriale et l’autodétermination, des questions qui n’étaient pas explicitement posées par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il souligne que cette approche a créé une confusion juridique, souvent exploitée par certaines parties pour justifier des positions politiques. Il note, par ailleurs, que l’Avis de la CIJ, bien qu’influent, n’a pas force obligatoire, ce qui limite son impact sur le terrain.
Pour étayer son analyse, l’auteur revient sur des précédents juridiques internationaux où des avis consultatifs de la CIJ ont influencé des décisions politiques, comme dans l’affaire de la Namibie en 1971. Il insiste, cependant, sur la différence fondamentale entre des contextes coloniaux clairs et des situations complexes, comme le cas du Maroc qui a subi une atteinte à son intégrité territoriale sur le Sahara en raison de la colonisation franco-espagnole, avant de récupérer progressivement ses territoires colonisés entre 1956 et 1975.
2- La reconnaissance internationale et la « reconnaissance prématurée »
Un autre point essentiel a été abordé par le Pr. Matsumoto, à savoir la question de la reconnaissance internationale des entités sécessionnistes. En prenant l’exemple historique du Mandchoukouo, une entité créée par le Japon en Chine dans les années 1930, il démontre comment une reconnaissance hâtive peut avoir des conséquences déstabilisatrices.
Dans le cas du Sahara, l’auteur estime que la reconnaissance de la « RASD » (République arabe sahraouie démocratique) par certains États et Organisations, comme l’Union africaine (UA), constitue une « reconnaissance prématurée ». Il soutient que tant que le Maroc n’a pas renoncé à sa souveraineté sur ce territoire, toute reconnaissance de la « RASD » viole les principes d’intégrité territoriale et d’interdiction d’intervention dans les affaires internes.
L’auteur propose une étude comparative entre les positions des différents États membres de l’Union africaine et de l’ONU, soulignant les divergences entre les principes affichés et les pratiques réelles en matière de reconnaissance.
3- De la décolonisation à l’autonomie
a. L’accord de Madrid et la décolonisation
L’accord de Madrid de 1975 constitue une étape cruciale dans le processus de décolonisation du Sahara. Signé entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie, cet accord prévoyait le transfert de l’administration du territoire aux deux derniers pays. Pr. Matsumoto défend l’idée que cet accord est juridiquement valide, contrairement aux critiques qui invoquent l’absence d’un référendum.
En scrutant les obligations de moyens et de résultat en droit international, l’universitaire Matsumoto explique que l’Espagne a rempli son obligation de moyens en transférant l’administration. L’obligation de résultat, qui vise à rétablir le territoire dans son état précolonial, n’a quant à elle pas encore été réalisée en raison des actions du polisario et du soutien algérien à l’organisation séparatiste.
Pour appuyer son propos, le Pr. Matsumoto analyse des accords similaires dans d’autres contextes coloniaux, comme la transition de Hong Kong de la Grande-Bretagne à la Chine. Il montre comment les accords de transfert administratif peuvent être contestés, mais restent juridiquement valables tant qu’ils respectent les normes internationales en vigueur.
Dans ce cadre, l’ouvrage offre une nouvelle grille de lecture de la question du Sahara, identifie des lignes de clivage juridique incontestables autour des concepts clefs et donne de bonnes raisons pour démontrer l’illégalité de la « RASD » et de toute tentative de son intégration dans le système international ou régional.
La région du Sahara dont le polisario prétend réclamer l’« indépendance » était une ancienne colonie espagnole. La région a été restituée au Maroc en toute légalité par l'Accord de Madrid, en 1975, dans lequel l'Espagne a exprimé sa volonté de satisfaire les revendications marocaines pour décoloniser ce territoire. Cependant, le polisario a prétendument déclaré l’« indépendance » du territoire sans aucun accord préalable avec le Maroc qui exerce sa souveraineté sur cette région.
Une déclaration sans l'accord de l'État indépendant et souverain n'est pas recevable du point de vue du droit international.
Depuis 1965, l’ONU a demandé la décolonisation du Sahara. L'Espagne a tenté de remettre à plus tard la solution de cette question et, enfin, il a été déclaré dans l'Accord de Madrid que « L'Espagne ratifie sa décision réitérée auprès de l'ONU de décoloniser le territoire du Sahara en mettant fin aux responsabilités et pouvoirs qu'elle a sur ce territoire en tant que puissance administrante ». En vertu de cet accord, le Comité de décolonisation des Nations Unies a considéré que l'Espagne ne constituait plus le pays d'administration d’une région non autonome, mais le Sahara lui-même est resté sur la liste des territoires non autonomes.
En droit international, il est illégal d’accorder le statut d’État à des entités sécessionnistes comme la « RASD », et l'acte de reconnaissance n’a aucun effet juridique et doit être considéré comme étant préjudiciable. Pour cause les trois raisons suivantes :
- le fait de reconnaître les indépendantistes faisant partie d'un État reconnu est en contradiction avec la reconnaissance internationalement établie de cet État ;
- ingérence dans les affaires intérieures de l'État existant ;
- un tel acte de reconnaissance est une violation de l'intégrité territoriale de l'État existant.
Comment peut-on, donc, respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ?
Les déclarations d'indépendance qui libèrent du régime colonial doivent être respectées, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutefois, les déclarations émanant de ceux qui font sécession des États non-coloniaux, comme c’est le cas pour les fondateurs de la « RASD », ne doivent être ni validées ni considérées.
Si la reconnaissance d’une entité sécessionniste d'un État non reconnu est tout simplement nulle en droit international, elle est dans le cas de la sécession d'un État reconnu, non seulement nulle, mais aussi internationalement illicite, car elle porte atteinte à la souveraineté de l'État reconnu en affirmant la violation de son intégrité territoriale par voie de sécession.
b. L’Initiative marocaine d’autonomie
L’Initiative marocaine d’autonomie, proposée en 2007, est présentée par le Pr. Matsumoto comme une solution réaliste et conforme au droit international. Elle offre une large autonomie aux habitants des provinces sahariennes tout en respectant la souveraineté marocaine. L’auteur souligne que cette approche permettrait de sortir du blocage actuel, en évitant les écueils d’un référendum polarisant.
L’auteur insiste également sur les aspects pratiques de cette Initiative, notamment sa capacité à promouvoir le développement économique et social des provinces concernées. Selon lui, les objections des opposants à cette Initiative sont davantage motivées par des considérations politiques que par une analyse juridique rigoureuse.
En outre, l’auteur examine les réactions internationales à cette Initiative, citant les soutiens explicites de certains pays européens et africains, ainsi que les réserves ou refus exprimés par d’autres acteurs, comme l’Algérie. Cette analyse met en lumière une autre réalité plus liée aux dynamiques diplomatiques entourant le conflit.
Lorsqu’il est question du droit à l’autodétermination, il est essentiel de préciser si celui-ci est envisagé comme un principe politique, un droit légal, un droit à l’autodétermination dans un contexte de domination coloniale, ou encore comme un droit à l’autodétermination à l’intérieur d’un État indépendant et souverain.
Il convient de rappeler que, dans le passé, l’autodétermination était perçue comme un principe essentiellement politique, souvent associé à la séparation et à l’indépendance. Ainsi, ce concept, mentionné dans les 14 points de Wilson en 1918, a conduit à la fragmentation de l’Empire ottoman et de l’Empire austro-hongrois. Plus tard, le « principe de l’autodétermination des peuples », inscrit dans les Articles 1er et 55 de la Charte des Nations Unies, a soulevé des débats quant à sa nature : est-il un principe politique ou juridique ?
Sur le plan juridique, ce concept est évoqué dans des traités internationaux. Toutefois, il demeure difficile d’identifier clairement les conditions essentielles de sa mise en œuvre ou ses implications juridiques spécifiques. Lorsqu’il est formulé par l’Assemblée générale des Nations Unies ou par la Cour internationale de justice, ce principe peut être appliqué de manière indirecte. À cet égard, l’Assemblée générale a joué un rôle clé en adoptant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, ainsi que la Déclaration des relations d’amitié en 1970 qui a permis l’application en pratique du « principe de l’autodétermination des peuples ».
De la même manière qu’il convient d’aborder la question de savoir si le droit international reconnaît un droit à la séparation et à l’indépendance. Cette question soulève deux aspects distincts : l’indépendance des territoires non autonomes et la scission au sein d’un État souverain et indépendant. Dans le cas des États souverains, le principe de l’intégrité territoriale est prédominant. Toutefois, selon la Déclaration des relations d’amitié, les territoires non autonomes ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante de l’État auquel ils sont rattachés.
En revanche, la séparation et l’indépendance d’un État souverain et indépendant, même lorsqu’elles s’inscrivent dans l’exercice du droit à l’autodétermination, entrent en conflit avec le principe de souveraineté territoriale. L’article 6 de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays coloniaux stipule explicitement que « Toute tentative visant à détruire l’unité nationale ou l’intégrité territoriale d’un État est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies. »
Enfin, la séparation et l’indépendance vis-à-vis d’un État souverain et indépendant doivent être examinées à travers le prisme du système de reconnaissance des États. Dans la perspective du droit international, pour qu’un territoire accède à l’indépendance et soit reconnu comme un État, celui-ci doit obtenir la reconnaissance d’autres États. Or, cette reconnaissance ne fait pas l’objet d’un consensus général au sein de la communauté internationale, car elle relève souvent de décisions politiques individuelles de chaque État. Par conséquent, tant que la reconnaissance demeure une prérogative discrétionnaire des États, il est difficile d’établir une règle juridique universelle régissant la séparation et l’indépendance des États souverains.
L'Organisation des Nations Unies est maintenant dans une véritable impasse : que faire pour résoudre le problème du Sahara ? Relancer et faire progresser simultanément le dialogue direct (actuellement suspendu) entre les principales parties à Manhasset, tout en maintenant dans son agenda la perspective d'un référendum d'autodétermination des habitants, sous l'égide de la MINURSO, créée en 1991 par le Conseil de sécurité ?
Faut-il reconnaitre aujourd’hui que la proposition du référendum qui date de 30 ans n’a pas pu résoudre le problème, situation qui s’explique par trois raisons :
- le référendum qui offre le choix entre indépendance et intégration au Maroc met les parties dans une situation gagnant-perdant, ce qui entraîne le fait de tout gagner ou tout perdre ;
- la résolution finale du problème est expédiée à plus tard, poussant ainsi les parties à manœuvrer pour obtenir un maximum de votes et de temps ;
- le référendum a été considéré comme un substitut à la décolonisation, bien que la décolonisation n’ait pas d’autre choix que de restituer la colonie à son état initial dans lequel elle était lors de sa colonisation.
L'ONU a inscrit le Sahara sur la liste des territoires non autonomes, c'est-à-dire, identifié comme une colonie, sans signaler son pouvoir d'administration, alors que l'Organisation de l’Unité africaine, aujourd'hui l’Union africaine (UA), a reconnu la « RASD » comme un État. C’est une contradiction pour les États membres de l'ONU et de l'OUA, si l’on juge par l’éventuel résultat du référendum, car il s’agit d’un problème juridique tellement ardu que ça peut nécessiter un autre avis consultatif de la Cour internationale de Justice. La question pourrait être, par exemple, de savoir si le fait de considérer un territoire non autonome comme État indépendant et souverain ne constitue pas en fait une contradiction flagrante avec les articles 73 et 103 de la Charte des Nations Unies.
Le polisario et l'Algérie soutiennent que le territoire du Sahara est celui de la « RASD », alors que le Maroc le considère comme étant partie intégrante de son territoire national. La voie référendaire peut-elle aider à résoudre cette confrontation et contradiction quant au statut actuel, et non pas dans l'avenir ? Car le referendum ne fonctionne que pour l’avenir du territoire. Son statut juridique actuel doit être résolu par l'interprétation et l'application du droit international d’aujourd’hui. N'existe-t-il pas alors une loi internationale qui puisse avoir un impact décisif sur son statut juridique ?
Depuis 1960, la domination coloniale a été plusieurs fois déclarée illégale dans les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Depuis lors, la domination coloniale est en violation des obligations internationales. Ainsi, les États coloniaux assument la responsabilité internationale pour un fait internationalement illicite. Basés sur le droit de la responsabilité en droit international, les dommages causés par des actes internationalement illicites devraient être compensés par un retour à la situation originale qui existait avant les actes. Ainsi, le territoire colonisé doit être restitué à la situation qui existait au moment de la colonisation. La restitution dans le cas des colonies varie selon les deux situations suivantes au moment de la colonisation :
la terra nullius colonisée devrait être restituée à la terra nullius. Comme les habitants de la terra nullius qui est restituée occupent le terrain, le territoire est considéré comme celui des résidents ;
la restitution de l'ensemble du territoire colonisé doit correspondre à sa restauration sur le territoire d'origine lors de sa colonisation.
4- Sur le plan méthodologique
L’approche intégrée du Pr. Matsumoto au droit international transcende l’école formaliste en proposant un cadre multidimensionnel. Cette approche repose sur une double articulation entre des composantes juridiques et humaines. Sur le plan juridique, l’analyse de l’auteur est solidement ancrée dans les principes fondamentaux du droit international, tels que le jus cogens, la souveraineté et la reconnaissance des États. Il met en avant la nécessité de garantir une stricte adhésion aux normes mondiales et aux standards juridiques établis, considérés comme des piliers essentiels pour maintenir l’équilibre et la justice au sein de la communauté internationale.
En parallèle, l’approche de l’auteur accorde une attention particulière à la dimension humaine. Il met en lumière l’importance de prioriser les droits, le bien-être et les aspirations des populations sahraouies, un aspect central dans ses recherches. De plus, il prône l’intégration des cadres des droits de l’homme dans les pratiques de gouvernance, tout en veillant à promouvoir une gouvernance équitable et inclusive. Cette double approche, juridique et humaine, offre une vision holistique et équilibrée du droit international appliqué à des questions complexes comme celle du Sahara.
Dans le cadre de son travail, le Pr. Matsumoto intègre également des considérations historiques et sécuritaires qui enrichissent son analyse multidimensionnelle. Il reconnaît les héritages coloniaux, les revendications territoriales et les traités comme des éléments fondamentaux pour comprendre la légitimité des positions des différentes parties. Il souligne que la légitimité peut être renforcée par une compréhension approfondie du contexte historique et des précédents juridiques.
Par ailleurs, l’analyse de l’auteur met en évidence le rôle crucial de la stabilité en Afrique du Nord dans le maintien de la paix internationale. Il examine également la question du Sahara comme un facteur central influençant les alliances régionales et les mécanismes de résolution des conflits, en soulignant son impact sur les équilibres géopolitiques.
Sur le plan méthodologique, le Pr. Matsumoto adopte une approche rigoureuse et empirique pour aborder la question du Sahara. Il observe que de nombreux ouvrages ont été publiés sur ce sujet au cours des 50 dernières années. Cependant, sa perspective se distingue par son adoption d’un point de vue tiers et par une méthodologie empirique traditionnelle.
Pour déterminer les règles du droit international applicables, il privilégie une observation libre de tout préjugé, s’appuyant sur les traités, le droit international coutumier, les décisions judiciaires et les principes généraux du droit international. Il explique que la plupart des règles contenues dans les projets de conventions adoptées par la Commission du Droit international confirment et réaffirment les normes existantes, elles-mêmes fondées sur les pratiques étatiques et les décisions des tribunaux.
Le Pr. Matsumoto insiste également sur l’importance d’interpréter ces règles conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les règles ainsi interprétées doivent être appliquées aux faits reconnus par toutes les parties ou établis officiellement. Cependant, il reconnaît que certains faits restent confidentiels en raison de leur statut de « secrets d’État », ce qui nécessite de s’appuyer sur des preuves indirectes pour les établir.
Il souligne également que même les décisions judiciaires ne sont pas toujours exemptes de motivations politiques ou idéologiques. Par conséquent, il recommande une lecture critique de ces décisions, en mettant l’accent sur le raisonnement logique et les méthodes d’interprétation prescrites par la Convention de Vienne. Ce n’est qu’après une telle analyse critique que ces décisions peuvent être utilisées comme précédents pour établir des règles applicables.
Ces méthodes, largement adoptées par les experts du droit international, témoignent de la rigueur et de la pertinence de l’approche du Pr. Matsumoto, lequel reconnaît néanmoins que toute analyse est susceptible d’être influencée par des motivations diverses, qu’elles soient politiques, idéologiques ou personnelles. En ce sens, il plaide pour la prise en compte des opinions tierces, considérées comme essentielles pour garantir une analyse équilibrée et impartiale.
Dans son ouvrage, le Pr. Matsumoto propose une recherche approfondie sur la question du Sahara, menée d’un point de vue neutre. Bien que sa méthodologie empirique soit traditionnelle, il met en avant les innovations dans le droit international qui ont émergé au cours des 50 dernières années. Ce cadre multidimensionnel, qui associe des perspectives juridiques, humaines, historiques et sécuritaires, permet de résoudre les différends territoriaux de manière juridiquement solide, historiquement informée et socialement équitable. Le Pr. Matsumoto souligne également que cette approche reconnaît les implications plus larges pour la stabilité régionale et la paix mondiale, offrant ainsi une contribution significative au débat international.
5- Conclusion
Le livre du Pr. Matsumoto Shoji se distingue par la profondeur de ses analyses et la clarté de son argumentation. En combinant une perspective juridique rigoureuse avec une compréhension fine des dynamiques politiques, il offre une contribution majeure au débat sur la question du Sahara.
Bien que certains aspects, comme la question de l’autodétermination, mériteraient une exploration plus détaillée, l’ouvrage constitue une référence incontournable pour quiconque s’intéresse à ce conflit. Pr. Matsumoto montre que la voie vers une résolution passe par le respect des principes du droit international, tout en tenant compte des réalités politiques et économiques de la région.
En conclusion, « The Sahara Conflict and International Law » est une référence essentielle pour comprendre les enjeux juridiques, historiques et diplomatiques qui sous-tendent ce conflit complexe.