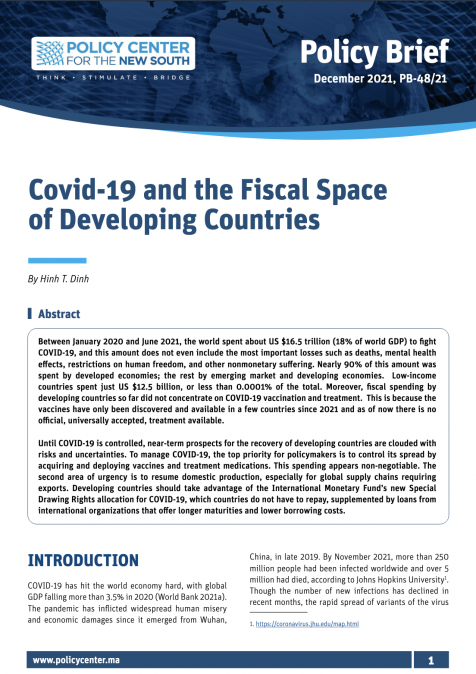Publications /
Opinion
En l’espace d’une année, la Banque mondiale (BM) a enregistré deux démissions parmi son top management. Il y a douze mois (Janvier 2018), Paul Romer quittait la Banque mondiale pour retourner dans le monde académique. Au début de ce mois de janvier 2019, Jim Yong Kim annonce son départ de la présidence de la même institution pour rejoindre une autre spécialisée dans le financement des infrastructures.
Pour Paul Romer, les critiques à l’endroit du classement Doing Business, et la réaction du gouvernement du Chili, n’ont certainement pas été étrangers à son départ. Jim Yong Kim, quant à lui, a invoqué le souhait de s’orienter désormais vers une institution privée, dédiée au financement d’infrastructures dans les économies en développement.
Il ne s’agit pas, ici, d’une analyse sur les causes de ces différents changements et départs dans le top management de la Banque mondiale, mais plutôt de discuter les deux éléments suivants : dans quelle mesure cette situation à la Banque mondiale serait une opportunité pour quelques réformes (même mineures) des accords de Bretton Woods et, ensuite, allons-nous assister à un recul de l’engagement de la Banque mondiale sur le terrain du développement dans les pays les plus fragiles ?
Les deux questions suscitées renvoient, dans une certaine mesure, à la crainte exprimée par des analystes de voir un symbole fort du multilatéralisme ébranlé. Autrement dit, l’option qui semble être celle de l’administration américaine sous Trump (celle d’un unilatéralisme sur les grandes questions mondiales) risque-t-elle de se traduire par un recul de l’engagement américain en faveur du développement économique dans les PED ? Un recul américain qui entrainerait à son tour un désengagement d’une Banque mondiale (sous influence de l’administration américaine) sur le financement multilatéral du développement.
L’appui au développement en péril ?
Au regard de certains éléments, le risque de voir l’administration américaine et, par ricochet, la Banque mondiale, revoir significativement leur contribution, à la fois dans la réflexion et le financement de l’appui au développement, paraît assez négligeable.
Le premier argument est simplement statistique.
• Il y a, d’abord, l’évolution des décaissements de l’aide publique américaine au développement. La Figure-1 montre assez clairement que l’assistance au développement américaine depuis plus d’une décennie (période pendant laquelle se sont succédé des gouvernements démocrates et conservateurs) tourne autour de 0,2% du PNB. A cet égard, le seul procès qui peut être fait est celui de la promesse non tenue de dédier au moins 0,7% du PNB à l’aide au développement.
• Pour le cas de la Banque mondiale, ses dirigeants ont récemment réaffirmé l’option ferme (à travers une contribution de son président sortant M. Jim Yong Kim in Foresight Africa – Brookings institution 2019) d’apporter un soutien plus important aux économies en développement, plus particulièrement celles en situation de « fragilité conflit et violence ». L’objectif de vaincre l’extrême pauvreté à l’horizon 2030 reste plus que jamais la pierre angulaire des actions de la Banque mondiale. A ce titre, entre 2016 et 2018, la BM a investi plus de 4 milliards de dollars en soutien aux initiatives privées dans les pays dits fragiles. De plus, la figure-2 montre une évolution des décaissements de la Banque mondiale, qui ont repris après une chute observée en 2010. Et en l’état actuel des données disponibles, aucun argument ne laisse envisager une chute de l’aide au développement.

Un second ensemble d’arguments relève davantage de la géopolitique. A ce niveau, se rejoignent deux faisceaux d’idées avec, d’abord, la percée de la Chine comme partenaire important pour beaucoup de pays en développement, notamment ceux d’Afrique subsaharienne, ensuite et, surtout, le développement économique qui est un outil central dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme dans les zones les plus vulnérables.
Même si la « concessionnalité » des interventions chinoises reste assez discutable, elle renforçait ses engagements en 2018 en termes de financement pour l’Afrique, avec une promesse de 60 milliards de dollars. Ainsi, il est indéniable que les rivalités sino-américaines se sont transportées sur le terrain du continent africain. Dans un récent discours, M. John Bolton, en déclinant la stratégie africaine du président Trump, n’a pas raté l’occasion de dénoncer (en usant d’adjectifs très forts) les actes posés par la Chine et la Russie, tous deux accusés de comportements voraces et déloyaux envers les intérêts américains en Afrique (White House Briefing, 2018).
Malgré le discours assez critique sur la qualité des institutions dans les pays du continent africain, et la menace de réduire, voire de couper, l’aide aux « mauvais élèves », l’administration américaine s’est résolue à prendre tout cela à contre-pied et de quasiment doubler le budget du « Overseas Private Investment Corporation ». Le gouvernement américain est, dès lors, conscient que face aux importants besoins de financement et d’infrastructure en Afrique, tout désengagement de sa part tournera à l’avantage de la Chine qui représente une alternative crédible pour les économies en développement. Cet argument paraît, également, valable pour spéculer sur les interventions à moyen terme de la Banque mondiale. Affaiblir cette dernière sur le terrain du multilatéralisme reviendrait à tourner davantage les Etats en développement vers les capitaux chinois et, dans une moindre mesure, russes.

Doit-on (dans l’immédiat) réformer Bretton Woods, et à quels prix ?
Dans l’immédiat, et comme cela a été le cas il y a six ans, se pose l’épineuse question du choix de la personnalité devant diriger l’institution de Washington. L’arrangement, tacite depuis 1944, a été de laisser le poste de président de la Banque mondiale aux USA et celui de directeur général du FMI aux Etats européens. Les économies émergentes réclament de plus en plus que cette répartition soit revue, car la structure de l’économie mondiale est bien différente de celle qui prévalait en 1944.
Dans les cercles spécialisés, certains noms de successeurs sont avancés, tels que Michelle Bachelet (ancienne présidente du Chili), Ngozi Okonjo Iweala (ancienne ministre des finances du Nigéria), Nelson Barbosa (ancien ministre des Finances du Brésil) ou encore le Chinois Justin Yifu Lin (ancien économiste en chef à la Banque mondiale) ; il ne nous aura pas échappé que toutes ces personnalités sont originaires de pays émergents.
Quel que soit le candidat qui sera retenu par le Conseil d’administration de l’Institution, celui-ci devra s’intéresser à un certain nombre de questions déterminantes sur l’avenir de l’appui au développement. Entre autres questions, il y a l’épineux critère d’allocation de l’aide qui doit corresponde aux réalités et besoins des pays en développement en cette deuxième décennie du 21ème siècle. Par ailleurs, la Banque mondiale aura besoin d’éclaircir sa position sur l’idée rampante de la titrisation de l’assistance au développement.